Face aux enjeux du dérèglement climatique et de la perte de biodiversité, l’humanité est confrontée aux questions du modèle de société, de la croissance économique, de l’exploitation des ressources premières, de la préservation du vivant … pour garantir sa survie. Le débat entre économie et écologie apparaît encore politiquement comme un choix entre la bourse et la vie, entre le maintien ou le changement du modèle de développement économique des sociétés productivistes, entre la préservation de nos conditions matérielles de vie et celles de la vie même.
Pour alimenter la réflexion sur la direction à prendre, voyons comment Alain Deneault, philosophe québécois, traite cet enjeux d’idéologie politique dans son dernier ouvrage intitulé Mœurs de la gauche cannibale à la droite vandale.
Faire durer le développement.
Des décennies de politiques d’extrême centre n’ont pas polarisé la gauche et la droite, mais les ont confinées à des chimères. Un million d’espèces menacées de disparition, un climat qui surchauffe, des glaciers qui fondent et s’effondrent, des forêts qui brûlent, des eaux qui engloutissent des villes, un désert qui avance au rythme de réfugiés climatiques refoulés par hordes… Les raz-de-marée, les ouragans, les famines, les guerres civiles, le fascisme de vociférateurs éperdus, les communautés de fortune qui se réinventeront pour sauver le peu qui restera… À quoi peut-on encore sérieusement s’accrocher ?
Aptes à sentir ce qui vient, nous nous montrons incapables d’en parler. Nous avons pour nous y essayer, des syntagmes technicistes plein la tête. C’est en termes de dioxydes en parties par millions, de température mondiale moyenne comparée à l’ère précédant les machines à charbon, de Terriens responsables de l’Histoire universelle, de modèles comptant les années par paquets de millions… que nous partons en quête d’une spiritualité perdue. Des idéologues offrent une formidable adversité pour que nous en restions là. Tous les vocables donnés en partage, visent à faire de l’adhésion au capital un horizon indépassable. Doit demeurer impensée l’idée même d’un modèle autre se substituant à l’ordre marchand voulu mondialement par des entités hégémoniques. La “ gouvernance ” radie le terme devenu ancien de “ politique ” et place les règles de l’entreprise au centre de tout modèle d’organisation de la vie sociale. L’expression “ développement durable ” gomme celle de “ société durable ” du Club de Rome et place les entreprises, non plus en position d’objets d’études, mais de sujets, non plus en position de problèmes, mais de solutions. L’“ acceptabilité sociale ” biffe ses ancêtres les “ projets de société ” et ne devient plus que réactive à ce qui s’offre à elle. Les “ ressources humaines ” raturent tout ce qu’il pouvait y avoir de personnel à la lutte des classes, lesquelles sont entre-temps devenues des “ parties prenantes ”. C’est en décelant dans des points de croissance la confiance du peuple que nous cherchons à ré-enchanter le monde. Des barbarismes nous occupent les mâchoires comme des cailloux : “ clientèles ”, “ valeurs ajoutées ”, “ compétitivité ”, “ processus ”, “ croissance ”… À l’aune de ces variables désespérons-nous de nous donner une psychologie : l’optimisme, la relance, l’indice du bonheur…
Œuvre éloquente de la récupération par le régime du discours et de la sensibilité écologistes, le rapport onusien au titre insignifiant, Notre avenir à tous, ayant jeté les bases, en 1987, de la notion de “ développement durable ”. Son auteure, l’ex-première ministre de Norvège et ex-ministre de l’Environnement Gro Harlem Brundtland, a signé le rapport après avoir été nommée présidente d’une commission baptisée “ Développement et environnement ”, qui annonçait déjà les thèses et la conclusion, à savoir que le développement et l’environnement se montrent non seulement compatibles, mais que seul le premier rendrait possible la protection du second. Surtout, ce rapport beaucoup plus idéologique que scientifique, se voulait une réponse bien particulière à celui déterminant, signé par le Club de Rome en 1972, “ Les limites à la croissance ” ou le rapport Meadows. Ce rapport consistait à présenter comment la croissance du capital et, par conséquent la pression que la grande industrie fait subir sur les territoires et océans, concourt à sa perte et constitue le problème essentiel du phénomène massif de pollution et d’annihilation du vivant en bien des endroits du monde. Le rapport Brundtland ne conteste pas ces données ni ses analyses, il les réplique seulement, c’est-à-dire qu’il les reproduit en se positionnant comme la référence de prédilection en matière écologique, avec pour seule nuance la conclusion et l’intitulé qui chapeaute la démarche, à savoir que le souci écologique doit se penser par le prisme du développement, de la prospérité et de l’industrie plutôt qu’à son encontre. Pour le régime, depuis l’ONU, il ne s’agit pas tant de militer pour ses thèses et de leur conférer force de loi qui vont entrer en vigueur dans différentes législations du monde, que de continuer à les inscrire de manière plaquée dans un corpus de référence qui les contredit. Préconiser ainsi le “ développement durable ” plutôt que la “ décroissance ”, c’est-à-dire tabler sur le rapport Brundtland plutôt que celui des Meadows pour aborder la question écologique, c’est la penser en adoptant un lexique orwellien pour se persuader que la “ cause du problème ” est en réalité sa “ solution ”, c’est plaqué un discours intéressé sur une situation qui exige de la grandeur, c’est cherché à prendre conscience d’un phénomène dramatique à partir d’attrape-nigauds. Car un impensé doit subsister dans la démarche : envisager dare-dare la fin du capitalisme en tant que cause du marasme. Tant qu’on peut sacraliser la doctrine du capital, tant qu’on peut en faire la source exclusive de toute action politique et sociale, y compris pour remédier à ce qu’il détruit, tout discours pourra être entendu. La “ durabilité ” et la “ viabilité ” de tout programme et de tout engagement seront recevables tant que c’est au nom du “ développement ” et de la “ prospérité ” qu’on l’envisagera. Le “ discours vert ” sera bienvenu tant qu’il servira d’épithète à un capitalisme. “ L’intégration territoriale ” sera admissible tant qu’elle participera de la “ gestion ”. Ces intitulés sont cruciaux : ils fondent les prémisses implicites qui entrent en contradiction avec les prétentions et les dualités stériles : choisir entre l’écologie et l’économie ; soumettre les avancées en matière écologique aux lois du marché et à l’ingérence techno-instrumentale ; mettre dans la balance la protection du territoire et la création d’emplois…
Les États n’en finissent plus de convenir que la catastrophe est imminente, que l’heure des changements radicaux est venue, que la situation est grave, sans toutefois ne jamais remettre en cause leur bilan. Car, dans toutes leurs manifestations rhétoriques, un impensé doit demeurer : que le développement industriel et l’impératif de croissance soient contestés, comme notions, de manière critique. À la fin des années 1980, cet aberrant syntagme “ développement durable ”, comme bien d’autres expressions appartenant au régime idéologique de la gouvernance, s’est imposé dans le jargon ministériel, même dans les discours militants et jusque dans les intitulés de programmes et des centres de recherche. Pourtant, on ne doit pas ce genre d’expression à aucun chercheur particulier, à aucune instance universitaire indépendante ou à quelque intellectuel de renom, mais à des organes gouvernementaux réputés près de l’entreprise privée. Le concept est devenu le cri de ralliement de tous ceux qui s’intéressent au développement économique et à la protection de l’environnement, c’est-à-dire à l’harmonisation de l’économie et de l’écologie… C’est un peu comme si madame Brundtland et son équipe de commissaires avaient réussi à trouver une formule magique capable de réconcilier les militants de l’écologisme et les tiers-mondistes d’une part, avec les bureaucrates gouvernementaux et les entrepreneurs développementalistes de l’autre. C’est l’objectif. Ce procédé alchimique s’est rapidement trouvé absorber par la grande industrie et la haute-finance comme un simple élément de rhétorique. D’un point de vue épistémologique, cette notion de “développement durable ” prévoit la production de données modélisées afin d’organiser un équilibre dans le rapport entre le “ développement ” et le “ vivant ”. D’une part, on réfléchit à l’empreinte humaine dans son activité (quantité de poisons pêchés, nombres d’hectares de forêts coupés, masse de dioxyde de carbone envoyée dans le ciel) et la capacité de l’habitat naturel à encaisser ces impacts pour se régénérer lui-même. Cela garantit donc la stabilité, la “ durabilité ”. Penser ainsi, c’est implicitement du moins, postulé les conditions de possibilités d’un tel équilibre. Or, la critique perçoit cette notion comme passéiste dans un monde en pleine mutation. Les conditions de possibilité ne sont plus réunies pour garantir la possibilité même d’un tel équilibre. Les gaz à effet de serre qu’on a propulsés dans le ciel il y a dix ans commencent seulement maintenant à avoir des répercussions, avec leurs boucles de rétroaction et leurs phénomènes exponentiels (fonte du pergélisol, libération du méthane contenu dans l’Arctique, réduction des glaciers qui entraîne sur les étendues marines une attraction des rayons solaires et une conservation de la chaleur, laquelle accentue cette même fonte…). Bref, il n’y a plus de substrat stable sur lequel s’appuyer pour gérer un rapport équilibré.
“ L’événement anthropocène ” disqualifie la notion de développement durable sur un plan épistémologique. Celle-ci laisse entendre qu’on peut réguler notre rapport à la nature, en articulant certains indicateurs pour maintenir disponible une ressources qu’on a l’intention d’exploiter encore très intensément. Or, à l’époque des bouleversements climatiques, de l’extinction de masse des espèces, de la contraction des espaces forestiers, de l’anthropocène et de la perspective multicrise à laquelle ils ouvrent au XXIᵉ siècle, rien n’est égal par ailleurs, tout bouge, tout se transforme. Pour le pire et de façon irréversible. Dans un temps où le substrat même de la nature est altéré en profondeur par les effets destructeurs de l’activité industrielle, s’enquérir de la modification de quelques paramètres ne suffit pas, alors que l’ensemble chavire et qu’il convient de se questionner sur un processus d’autodestruction.
Quelles qu’aient été les thèses et leur validité relative, le but était tout entier dans la conclusion : faire de l’entreprise privée, de son développement à l’origine de la crise écologique depuis le début de l’ère industrielle et des acteurs qui fanfaronnent sur les plus importantes tribunes sociales depuis des générations de régime oligarchique, les sujets de cette histoire et non pas ses objets. Autrement dit, force était de faire du développement le prisme par lequel une réponse allait être donnée à la crise et non un point qu’on se donnerait en tant qu’il dût être dépassé. Cela ne trompe plus les lecteurs avertis. Même ceux qui y ont cru un temps n’y voient aujourd’hui que du vent. Dans cette catégorie, Jem Bendell, spécialiste en la matière et professeur à l’université de Cumbria en Angleterre, fait même parti des repentis du développement durable. Il a en effet complètement revu ses positions : les changements climatiques comportent trop de conséquences majeures, irrémédiables et systémiques pour que nous puissions continuer à réfléchir en somnambules aux quelques paramètres que nous pourrions altérer pour maintenir le régime productiviste que nous servons ; il est anormal que les spécialistes du développement durable ne traitent jamais de ces questions de fond. Nous sommes donc de plus en plus nombreux à vouloir nommer sans détour ce qu’il en est de notre conjoncture, mettre fin aux coalitions stériles et aux discours mielleux qui taisent l’identité des coupables et qui s’accommodent du régime qui nous a plongés dans cet état de misère.
Le discours des “ petits pas dans la bonne direction ” tient de la bêtise quand on connaît la proximité des échéances qui nous séparent de ruptures historiques graves. Mais dans ce climat d’urgence, nous ne trouvons pas les mots pour faire de la question écologique une cause commune claire et conséquente. Le catastrophisme n’a de sens que s’il nous permet d’éviter la catastrophe, donc que s’il entre en lien avec une force historique capable d’actions. Or, les productions à grand déploiement, pas plus que les théories mathématiques se réclamant explicitement de la catastrophe, ne peuvent y parvenir. Que nous reste-t-il pour parler, pour se dire en notre temps ? Nos modalités de prise de conscience de la situation écologique dans laquelle nous sommes, elle reste pensée dans les termes, méthodes et discours des sciences qui ont contribué à nous y plonger. Car les analyses de l’excès de pouvoirs des sujets humains sur l’ensemble du territoire, des océans et du vivant – c’est-à-dire de l’anthropocène – proviennent précisément des sciences exactes qui ont présidé au développement d’appareils techniques et industriels de production ayant provoqué les maux qu’on constate. Ces géotechniciens, océanologues, climatologues et autres spécialistes ne font que paramétrer les approches selon lesquelles on devient à même de mesurer quelque peu l’état d’effondrement de la biodiversité et des bouleversements climatiques. Ils écrivent l’histoire, celle des mutations biologiques et climatiques qui nous oppriment et nous poussent vers un changement de paradigme brutal. Elle reste froidement technique, abstraite, aseptisée. Cette histoire se présente comme la résultante d’un vaste modèle tirant ses données de courbes démographiques, d’émissions de particules, d’indicateurs économétriques, de données productivistes a propos de matières premières, mais elle n’explique rien. Elle nous apparaît comme le symptôme d’une incapacité à nommer le problème en hissant notre conscience à sa hauteur, une incapacité à prendre la mesure de son envergure. Donc, pour en parler hormis la luminosité joyeuse qu’irradient les emballages verts et les utopies communautaires, il reste les sciences exactes, la technologie, la géo-ingénierie, le capitalisme vert. Ces éléments discursifs se mélangent tous en réalité. Un peu d’utopie se mêle à des pratiques consuméristes et à des données paramétrées fournies par des ingénieurs de la nature. Mais cette dernière source d’information est déterminante dans le façonnement collectif de notre conscience écologique. Car elle remplit un office idéologique dont notre régime actuel ne peut absolument pas se passer et qui continue à le perpétuer, à savoir rendre la perspective de son renversement ou de son interruption impensable. On ne se doute pas à quel point notre pensée écologique dépend des éléments de langage de cette droite libérale et capitaliste. Nous devons le terme “ d’anthropocène ” à Paul J. Crutzen, un chimiste et météorologue qui a d’abord réfléchi aux perspectives d’une guerre nucléaire pendant la guerre froide, pour ensuite renouveler ses analyses en fonction de l’enjeu climatique. De son point de vue d’architecte de la géo-ingénierie, le terme “ anthropocène ” ne témoigne chez lui d’une source d’inquiétude, mais au contraire d’une mission de l’humanité. Dans une optique impériale, il revient de droit aux sujets humains de gouverner le vivant ainsi que le climat afin d’en toujours mieux disposer. Il s’agit ici de méthodes techniques devant permettre de régler le climat mondial à la manière d’un thermostat universel, à partir d’éléments chimiques qu’on envoie dans le ciel par exemple, ou d’infrastructures permettant de réfléchir les rayons solaires.
La géo-ingénierie participe de toute une série d’approches visant, pour des détenteurs de capitaux et des acteurs de la technoscience, à prêter aux savoirs instrumentaux la capacité de trouver une solution aux problèmes écologiques de l’heure. Le capitalisme et son prodigieux appareil de production, sans parler de sa culture reposant sur la surconsommation et le gaspillage ne sauraient passer un seul instant pour les causes du problème mais pour les leviers permettant d’envisager encore l’avenir. Ainsi, les panneaux photovoltaïques, les batteries de pointe et autres tours éoliennes, ou encore l’exploitation du gaz naturel sur un mode non conventionnel, seraient censés nous protéger des crises écologiques puisqu’ils sont présentés comme émettant moins de ces gaz à effet de serre qui accentuent le réchauffement climatique… mais en négligeant de traiter les effets indirects qui concourent pourtant à leur augmentation (besoin massif de minerai qui entraîne ce type de pollution) et en faisant fi des autres aspects de l’écologie que ces procédés mettent en péril : les nappes phréatiques, les terres arables, les forêts, les modes de vie traditionnels non polluants.
Les régimes établis prétendent à la science du gouvernement et s’auréolent eux-mêmes d’une sagesse pour conduire les sociétés. Aussi ne répondent-ils jamais de leur bilan politique. Monopolisant l’ordre du discours pondéré et raisonnable, ils parviennent ainsi, à masquer leurs contradictions en poursuivant leur marche destructrice du vivant. La France et ses partenaires du G20 poussent l’outrecuidance jusqu’à faire ouvertement de la crise climatique l’objet d’un nouveau marché technologique profitant aux grandes entreprises qui l’ont provoquée, tout en reprenant en somnambule le refrain d’une lutte contre les bouleversements climatiques qui s’éloignent de toute réalité. Ainsi, pour l’Élysée, la “ transformation en profondeur de notre modèle ” signifie en réalité “ son intensification ”. Il ne s’agit en rien de minimiser le rôle du marché comme médiateur social, de retirer à la consommation nationale sa fonction de moteur de l’économie, ni de revoir le pouvoir exorbitant que détiennent ces nouvelles souverainetés privées que sont les multinationales, mais, nonobstant la crise écologique inouïe dans laquelle nous nous enfonçons d’ores et déjà, de garantir le maintien du marché comme régime d’organisation , le rôle que la consommation de masse y joue et la fonction dominatrice qui est dévolue aux multinationales. Les États accentuent même le trait en demandant en termes voilés aux multinationales d’assurer la transition écologique sans nuire à leurs intérêts, c’est-à-dire en garantissant, le cadre idéologique qui leur est profitable. C’est pourquoi l’Élysée fait de la transition énergétique une “ transition des consommateurs ” soutenue par l’état. On incite les gens à s’équiper d’appareils prétendument écologiques. Or, ce soutien de l’État, allant de l’échelle individuelle à l’échelle du territoire, en passant par les collectivités, suppose un déplacement de la pression. Les panneaux photovoltaïques, les batteries de pointe, les voitures électriques, tours éoliennes et autres représentent un leurre dont le marché de la transition a besoin pour prospérer. Au prétexte de minimiser la pollution atmosphérique, on met sous pression le secteur minier pour qu’il produise les infrastructures requises afin de transformer le soleil, l’air et l’eau en énergie utilisable. Pourtant, exploiter les terres rares ou l’uranium pour générer cette énergie et envisager un lourd travail industriel pour récupérer les alliages qui les composent lorsque ces appareils seront usés, constituent une source très importante de pollution. Ce problème se trouve “ externalisé ” dans le discours politique afin de donner aux solutions proposées un vernis de légitimité. Il reste ensuite à faire des conséquences dramatiques de ce type d’exploitation un nouveau marché. Pour traiter le taux ahurissant de monoxyde de carbone déjà émis dans l’atmosphère, les idéologues continuent de placer le marché au centre de tout, en voyant en ce problème l’occasion de nouvelles techniques hasardeuses, telles que la propulsion de particules de souffre dans la haute atmosphère, le fait de peindre massivement des espaces rocheux en blanc, le stockage du carbone dans le sous-sol ou encore de fertiliser l’océan avec du fer pour favoriser artificiellement, au mépris de l’équilibre écosystémique, la pousse d’algues captant le CO2. Tout, donc, pour maintenir en opération le régime productiviste en vigueur, voire le favoriser.
Alors qu’on commence, à notre époque, à mesurer l’impact du vaste appareil industriel sur le climat de la planète et l’habitat des humains, les innovations de la civilisation productiviste sont aptes à créer un nouveau sujet et sont capables de modifications d’une portée incommensurable autant dans l’espace que dans le temps long. Pour le philosophe Hans Jonas, l’homme lui-même a fait partie des objets de la technique ; considérant que la biologie cellulaire s’emploie à prolonger l’espérance de vie jusqu’à des seuils autrefois invraisemblables, que la manipulation génétique peut décider de son évolution ou que les sciences biomédicales interviennent dans le cerveau pour influencer les comportements en profondeur. La sociologue Céline Lafontaine a étudié les pratiques commerciales de la “ réingénierie du corps ” dans son essai intitulé Le corps-marché. La marchandisation de la vie humaine à l’ère de la bioéconomie. Proposant une solution biologique aux problèmes sociaux posés par le grand-âge, écrit-elle, l’entreprise s’inscrit dans une logique de capitalisation de la santé oùles individus sont appelés à investir financièrement en vue de prolonger leur vie. Et, de fait, la médecine ne consiste plus à faire reculer telle ou telle pathologie selon des méthodes circonscrites, ou à prévenir les maladies par une hygiène de vie indiquée, mais à combattre la dégénérescence la plus naturelle. L’important laboratoire américain Geron, par exemple, confère de la vraisemblance à ce qui s’apparente pourtant à une hallucination : grâce à ses recherches dans le domaine de la médecine régénératrice, doubler son espérance de vie apparaît soudainement possible pour des sujets nantis. La biotechnologie CRISPRse veut pour sa part un “ ciseau génétique ”apte à fragmenter l’ADN à des fins thérapeutiques avant la naissance, selon une approche ouvertement eugéniste. Cette nouvelle possibilité, rapide, précise et peu coûteuse de manipuler les gènes, soulève toutefois des enjeux éthiques, juridiques et sociaux. En utilisant cette technologie, les chercheurs peuvent désormais modifier les cellules de tout organisme vivant, dont les cellules germinales (spermatozoïdes et ovules). Et c’est là que le bât blesse. Autrement dit, les enfants pourraient hériter des manipulations génétiques qui seront éventuellement réalisées sur les cellules germinales de leurs parents. Ce pouvoir d’action n’est pas encore licite, mais qu’il soit envisageable constitue déjà une façon de repousser la frontière délibérative. Modifier le génome humain tandis qu’il est à l’état d’embryon et tenter de déterminer son ADN relèvent aussi d’un fantasme aujourd’hui à portée de main. Le tout commence par des expériences qui semblent vertueuse, comme celle pratiquée en Chine in vitro sur des jumelles, Lulu et Nana, afin de “ désactiver un gène pour leur conférer une résistance à l’infection par le VIH, virus responsable du sida ”. La liberté qu’on prend tendanciellement sur un type de sujet qu’on entend constituer, tel régime formant des militaires adaptés à certains critères spécifiques de performance, un autre des gestionnaires insensibles à la psychologie, quand il ne s’agira pas d’intervenir sur le cerveau pour produire d’éminents scientifiques. La science-fiction devient fade à l’aune de ces récits. Du reste, sur le plan de l’infiniment petit, les modifications génétiques directes et la mutagénèse, qui favorisent des mutations indirectes, transforment non seulement nos relations avec la nature, mais son essence même. Les essais de ce type se font le plus souvent en laboratoire et dans des cadres rigidement circonscrits, de telle sorte qu’il est impossible de mesurer à grande échelle et à long terme leur impact sur l’environnement, tant que les structures vivantes ainsi délibérément créées n’y sont pas jetées. Et les quelques expériences lancées à l’air libre laissent présager du pire : le maïs transgénique tue les abeilles, contamine les champs à tout va et relève de procédés généraux qui appauvrissent les sols.
La personne “ morale ” et son “ éthique ” des affaires.
La prétention à la pleine légitimité des affaires, à une légitimité propre au fait de mener des affaires, continue d’être invoquée dans des conditions historiques tout à fait préoccupantes. Qu’expliquèrent les représentants de la multinationale énergéticienne Total quand il fut su que des enfants, des femmes et des hommes infortunés avaient été contraints au travail forcé dans les années 1990 par la junte militaire birmane pour la construction de son gazoduc reliant la Thaïlande au golfe de Martaban ? “ La carte des gisements d’hydrocarbures dans le monde ne coïncide pas avec celles des régimes démocratiques ”, “ la mission de Total n’est pas de restaurer la démocratie dans le monde ; ce n’est pas notre métier ” ; “ un retrait forcé n’aurait pour effet que notre remplacement par d’autres opérateurs, probablement moins respectueux que nous d’une certaine éthique ”. Lorsque des opérations gazières, pétrolières, minières ou agro-industriels entraînent de l’esclavagisme, des guerres civiles, de la corruption… survient la rhétorique de l’économie ou… C’est-à-dire qu’on oppose sur les deux plateaux d’une balance imaginaire “ l’économie ”, d’une part et tout le reste, ensemble ou distinctement, d’autre part.
La légitimité des affaires, abusivement traduite dans le langage idéologique par le vocable “ économie ”, fut apte à s’ériger comme distincte et souveraine au regard des autres champs. Il est en réalité stupéfiant de voir à quel point le domaine des affaires a su s’élever au-delà des règles morales élémentaires, pour prêter des gages à ceux qui les transgressaient. Cette prothèse de l’esprit a pu servir de passeport pour commettre le pire tout en s’en justifiant. Une inversion complète de la logique élémentaire consiste alors à présenter comme légitime et morale un mode d’agir exceptionnellement contraire dans son essence même, à toute moralité. Cela revient à dire : oui, je me comporte de manière résolument opposée à tout code moral, mais suis-je pour ma part légitimé d’agir ainsi, évoluant dans un domaine d’exception qui lui échappe et encourage même qu’on s’en éloigne. De surcroît, ce retournement de principe arbore à son tour le terme de la “ légitimité ”. Dans cet état de la culture de l’entreprise, les sèmes “ moral ” et “ légitimité ” acquièrent un statut d’énantiosème (c’est-à-dire signifiant une chose et son contraire), comme le verbe “ remercier ” désigne à la fois le fait de reconnaître et de rejeter.
A posteriori ; on s’est demandé en “ éthique des affaires ” comment surmonter ce clivage, comment concilier la morale élémentaire telle qu’elle s’est traduite en théologie ou en philosophie à travers les âges et les missions qui étaient confiées aux employés d’une entreprise. La contradiction est au demeurant frontale. Il arrive même que des éthiciens des affaires fondent en théorie cette opposition observable entre la morale traditionnelle et celle du milieu des affaires s’est arrogée. Par exemple en réduisant la morale à des cas de conscience individuels, dans une affaire de malversation dont fut tenu responsable un employé : si le procédé est “ juridiquement condamnable” reconnaissent-ils, celui-ci reste “ moral du point de vue de l’entreprise ”, dans la mesure où l’entité pour laquelle il travail “ profite ” de son geste et que la fin ultime du travail de l’employé est d’œuvrer aux bénéfices et aux intérêts de qui l’emploie. Il peut donc se révéler moral d’être immoral quand on se montre immoral au profit d’une entité qui ontologiquement méconnaît la morale. Cette aberration de l’esprit passe la rampe à la condition de réduire la morale à un cas de conscience individuelle et d’ériger l’entreprise dans un au-delà des objets sociaux. D’autres entrepreneurs se dissimulent derrière la lettre de la loi pour plaider la légitimité de leurs actes.
Sur ces questions, Jennifer Abbott, Mark Achbar et Joel Bakan y vont, eux, d’une hypothèse sans fards et sans autocensure. Ils ont cherché à cerner ce qu’il en était du profil psychologique de la grande entreprise mondialisée, dans la mesure où celle-ci a acquis dans la modernité le statut de “ personne ”, qui plus est – ironie de l’histoire – de “ personne morale ”. Leur question : puisque, en l’entreprise, on a affaire en droit à une “ personne ”, quel est ce curieux monstre auquel les sujets politiques se sont soumis ? La réponse est froide et cruelle : l’entreprise est une personne psychopathe : manipulatrice, mégalomane, narcissique, enfermée dans des perspectives à court terme vue, incapable de remords, dépourvue de tout sens des responsabilités, insensible à la souffrance d’autrui, mais très au fait de ses propres intérêts.
Et pour compléter ce portrait clinique, j’ajouterai que son credo est que tout est permis sauf ce qui est interdit par la loi, et encore, si ça s’avère le cas devant un tribunal.
La nouvelle expertise qu’est l’éthique des affaires, vise essentiellement à prémunir le monde des affaires contre les pratiques, attitudes, discours et méthodes qui risqueraient, à terme, de concourir à sa perte. En éthique des affaires, la ligne idéologique stipule qu’il doit y avoir l’éthique, car celle-ci est “ profitable ”. Force est donc de comprendre qu’il ne peut y avoir éthique que si c’est profitable. L’éthique devient dès lors une dimension de la vie de l’entreprise. L’éthique ainsi instrumentalisée est toute entière soumise à cet impératif de la profitabilité. Mais alors qu’on la rende souveraine et, au contraire, elle pourrait ainsi s’imposer au point d’abolir le régime même de la profitabilité illimitée qui porte dans l’histoire le nom de Capitaliste. Un sens de l’éthique ancré subjectivement, partagé intimement, en serait un qui pourrait entraîner des raisonnements suffisamment libres pour concevoir sereinement le démantèlement des multinationales – pouvoir outrancier sur des enjeux névralgiques concentrés entre trop peu de mains et ce, à des fins vénales – ; celui des grandes banques – puissances capables de générer ex nihilo des devises et d’influencer des pouvoirs publics sans aucune légitimité politique – ainsi que le capitalisme lui-même comme idéologie – un régime de pensée qui postule l’organisation de la société au profit de l’idée de croissance, laquelle bénéficie de manière exponentielle à une minorité d’oligarques disposant de capitaux, à savoir des actifs excédentaires qui restent les médiations de rapports de pouvoir démesurés sur le réel. Lorsque dans le syntagme “ l’éthique des affaires ” le premier terme l’emportera sur le second au point de le faire disparaître au besoin, l’expression pourra être prise au sérieux.
Comment la recherche du profit à tout prix nuit à la santé humaine et environnementale.
Les travaux de recherche de Mélissa Mialon, biologiste, ingénieure agroalimentaire et docteure en nutrition, sur les déterminants commerciaux de la santé présentés dans son ouvrage Big Food & Cie, identifient les pratiques commerciales d’entreprise et les politiques des industriels ainsi que les moteurs mondiaux de la mauvaise santé humaine et environnementale. Nous présentons ici les points saillants de cet ouvrage qui traite également des solutions individuelles et collectives face à ces déterminants commerciaux de la mauvaise santé.
Si l’on regarde globalement notre situation sanitaire, on s’aperçoit que finalement cancers du poumon, maladies cardio-vasculaires, accidents de la route… ont tous pour protagonistes les industriels. Idéalement, ceux qui nous vendent des produits nocifs ne devraient pas pouvoir nous empoisonner. Ils ne devraient pas pouvoir nous mentir ou nous manipuler non plus. Les morts, les accidents, la pollution entre autres impacts négatifs de ces produits sur notre santé et notre planète, sont qualifiés “ d’externalité ”. Certains proposent qu’il incombe aux industriels de payer pour les dégâts qu’ils infligent à notre santé et notre environnement.
La santé publique vise à questionner et à changer les pratiques des industriels. Malheureusement, ces pratiques sont parfaitement autorisées, bien que critiquables en raison de leur impact sur notre santé et des inégalités qu’elles contribuent à creuser dans nos sociétés. Le travail de recherche de Mélissa Mialon est à la croisée de plusieurs disciplines : la santé publique, les sciences politiques et les sciences sociales et permet de contribuer au développement d’un nouveau pan de la recherche : les déterminants commerciaux de la santé.
Les déterminants commerciaux de la santé recouvrent l’ensemble des produits, pratiques, mécanismes et systèmes par lesquels les forces commerciales dictent et influencent la santé humaine et celle de notre planète et creusent les inégalités en matière de santé. L’analyse des déterminants commerciaux de la santé nous permet de comprendre que les industriels ont la mainmise sur notre santé et celle de notre planète. Ces déterminants commerciaux sont responsables de la majeure partie des maladies modernes et des décès. Par conséquent, si l’on veut vivre en meilleure santé sur une planète vivable et dans des sociétés moins inégalitaires, il est crucial de passer au crible les produits et pratiques des industriels. Lorsque Mélissa Mialon parle d’industriels, c’est au sens large du terme. Elle fait référence aux innombrables acteurs de l’activité industrielle, à savoir les producteurs de matières premières (dont les géants du pétrole), les fabricants (d’aliments transformés, de cigarettes, de médicaments, etc.), les distributeurs (supermarchés, sites de vente en ligne, etc.). Cela inclut également les tierces parties qui travaillent à leurs côtés : grossistes et détaillants, prestataires de services, tels que les organisations professionnelles (représentants du secteur du lait, celui de l’alcool, etc.), les entreprises de relations publiques, les fondations philanthropiques et certains instituts de recherche. Il est temps de prendre en compte l’ensemble des déterminants commerciaux de la santé quand on discute de santé publique et plus particulièrement de la responsabilité des industriels. C’est désormais incontournable si l’on veut trouver des solutions efficaces pour améliorer la santé des populations et réduire les iniquités sociales en matière de santé.
Quels sont les déterminants commerciaux de la santé ?
Tout d’abord, le produit industriel lui-même peut nuire à notre santé. Ensuite, certaines pratiques, comme le marketing visant à promouvoir ce même produit ou bien le lobbying, sont aussi nocives. Enfin, il existe des moteurs mondiaux de la mauvaise santé, tels que la mondialisation et les politiques néolibérales.
Les produits malsains.
La majorité des grands problèmes de santé publique contemporains tient à l’utilisation et à la consommation de produits que Mélissa Mialon qualifie de “ malsains ”. “ L’exploitation ” par l’homme d’éléments présents dans la nature (arsenic, plomb, amiante, etc.) pose parfois problème. D’autre fois, c’est la “ production ” de nouvelles substances (pesticides et autres produits chimiques) ou leur “ utilisation ” qui nuisent à la santé des agriculteurs, des ouvriers, des populations locales, ainsi qu’à l’environnement. La “ consommation ”, “ l’ingestion ” de certains produits, au premier rang desquels les aliments ultra-transformés, nous rend également malades. L’équipe de l’épidémiologiste brésilien Carlos Montero offre une nouvelles clé pour comprendre l’effet des aliments sur notre santé. Montero a proposé une classification des aliments selon leur degré de transformation. Cette classification distingue quatre catégories d’aliments :
Les aliments bruts ou peu transformés (œufs, fruits, légumes, champignons, etc.) ;
Les ingrédients culinaires transformés (huile, sel, épices, etc.) ;
Les aliments transformés (purée de fruits, pain frais, poisson fumé, etc.) ;
Les aliments ultra-transformés (bonbons, laits infantiles, nuggets, etc.). Les aliments ultra-transformés sont considérés par l’équipe d’épidémiologiste comme denses en énergie, riches en graisses malsaines, en amidons raffinés, en sucres libres et en sel et pauvres en protéines, fibres alimentaires et micronutriments. Les produits ultra-transformés sont conçus pour être hyperappétissants et attrayants, d’une longue durée de conservation et peuvent être consommés n’importe où, n’importe quand. Leur formulation, leur présentation et leur commercialisation favorisent souvent la surconsommation. Transformer un aliment consiste à le mélanger, tel quel ou peu transformé, à des ingrédients culinaires, par exemple, pour faire du fromage à partir de lait et de pressure, ou à mettre des légumes en conserve. Rien de plus. Mais pour obtenir un aliment ultra-transformé en revanche, on fractionne des aliments en différentes substances, comme l’huile, les protéines ou les fibres. Puis on réassemble ces substances, modifiées ou non, et l’on se retrouve avec un produit qui contient très peu d’éléments bruts : il n’a alors plus rien de commun avec un aliment qu’on aurait transformé dans nos cuisines. Montero et ses collègues qualifient les aliments ultra-transformés de “ formulations ”, un terme d’ailleurs utilisé par l’industrie elle-même. Plusieurs revues d’ensemble et méta-analyses de nombreuses études sur la question permettent désormais de conclure que plus la consommation d’aliments ultra-transformés est importante, plus le risque de surpoids, d’obésité et de syndrome métabolique est élevé au sein de la population. Les grands consommateurs de produits ultra-transformés ont, par exemple, un risque accru de développer une maladie cardio-vasculaire et donc de mourir prématurément. Qui plus est, les aliments ultra-transformés sont souvent emballés encore plus que les produits bruts ou peu transformés, si bien qu’ils ont un impact négatifs sur l’environnement, qu’ils participent à polluer.
Autant de produits industriels, autant de dangers.
L’alcool et la cigarette sont eux aussi des produits ultra-transformés. On sait que l’alcool est cancérigène et que son effet est irréversible sur le fœtus. On sait aussi que la cigarette fait des millions de morts chaque année, même chez les fumeurs dits “ passifs ”. Même si cela semble moins flagrant, l’utilisation de véhicules, d’armes à feu et certains médicaments, autres produits industriels, font courir des risques incontestables à l’homme. Respectivement, accidents de la route, agressions à main armée et effets secondaires des médicaments peuvent aussi tuer. Il est évident que conduire, être soigné et avoir accès à des produits industriels procure des bénéfices, de même qu’il existe des aliments sains, mais ce n’est pas l’objet du livre de Mélissa Mialon.
Les maladies non transmissibles (MNT) sont une manifestation d’un mode de vie dégradé.
Une maladie transmissible affecte un individu, qui ensuite peut la transmettre à un autre individu. L’infection à la Covid-19 ou la malaria sont des maladies transmissibles. Les MNT, au contraire, ne se transmettent pas d’un individu à l’autre. Dans cette catégorie, on trouve parmi les plus fréquentes les cancers, le diabète et les maladies cardio-vasculaires. Les MNT sont la principale cause de mortalité dans le monde : elles sont à l’origine de 71 % des décès, dont la plupart sont prématurés. Les MNT handicapent une grande partie de la population mondiale, qui doit vivre sous traitement médical et/ou ne peut plus exercer une activité professionnelle normale. La consommation d’alcool, de cigarettes et les régimes alimentaires malsains, en particulier quand ils sont composés d’une majorité de produits ultra-transformés, sont les principaux facteurs de risques des MNT. “ L’épidémie industrielle ” est l’épidémie galopante du XXIᵉ siècle. Les entreprises sont les “ vectrices ” de MNT et d’autres problèmes de santé, à l’image d’une nuée de moustiques transportant un parasite. En l’occurrence, les “ parasites ” sont les produits malsains qui rendent les gens malades. Ces produits rapportent beaucoup d’argent aux industriels, car ils sont simples à conserver (alcool, sodas, etc.) et fabriqués en grande quantité par une main-d’œuvre relativement bon marché. Pour que la boucle soit bouclée, alors qu’on incite de toutes parts à manger des produits ultra-transformés, les mêmes industriels nous proposent la solution : le régime ! À titre d’exemple, Weight Watchers et ses régimes minceur ont appartenu pendant plusieurs années au groupe américain Heinz, le célèbre roi du ketchup, qui continue d’ailleurs à produire certains aliments Weight Watchers, qu’on trouve au supermarché. Autrement dit, ceux qui nous promettent de nous aider à maigrir sont en fait proches des géants de l’agroalimentaire, qui fabriquent aussi des produits malsains qui nous font grossir. C’est l’application magistrale du cercle vicieux plutôt que du cercle vertueux ! Parfois, nos gouvernements perpétuent cette épidémie industrielle. La science est pourtant claire quand à l’ultra-transformation et à ses effets néfastes sur notre santé. Mais un décalage subsiste entre les scientifiques et leur application politique pour la protéger. Ce retard tient en grande partie aux pratiques politiques développées par l’industrie.
Une pression industrielle tous azimuts.
Les industriels génèrent également beaucoup de pollution et sont en grande partie responsables du changement climatique. En 2020, les trois plus gros pollueurs en ce qui concernent le plastique étaient Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé. Philip Morris, Colgate figurent aussi dans le top 10 au milieu d’autres entreprises agroalimentaires. Cette pollution d’origine industrielle est un sujet trop peu abordé en santé publique, alors qu’il est au cœur des problèmes de santé. En effet, on retrouve des résidus de plastique à tous les échelons de la chaîne alimentaire, dans tous les océans, en plus d’être présents dans tous les organismes humain et animal de la planète. Il est évident qu’il s’agit d’un problème majeur de santé publique lorsque l’on connaît ses effets perturbateurs sur la santé des organismes vivants. Aujourd’hui, les supermarchés des pays occidentaux sont saturés de produits ultra-transformés et presque tout le monde en consomme à l’excès. Mais l’alimentation se heurte à une limite physique : la taille de notre estomac. Les industriels, par conséquent, jettent leur dévolu sur les pays où le pouvoir d’achat des ménages augmente sans qu’ils achètent encore autant d’aliments transformés, d’alcool ou de cigarettes que nous. Au Brésil, par exemple, Nestlé livre ses produits par bateau aux populations indigènes vivant le long du fleuve Amazone. Le prétexte : les aider à se développer et leur donner accès à des “ aliments de qualité ” alors qu’ils sont évidemment ultra-transformés. Sous le même prétexte, Nestlé a développé à l’intention de ces mêmes populations des versions miniatures des produits vendus dans nos contrées, qui sont évidemment moins chers. S’agit-il vraiment de sortir ces populations de la pauvreté ? Les inciter à consommer des aliments ultra-transformés risque au contraire d’épuiser leurs maigres ressources, de fragiliser leur santé et les écosystèmes et de les détourner des produits locaux. À la manière de colons modernes, les industriels de la malbouffe apportent leur lot de MNT à des populations déjà vulnérables. Dans les pays riches, les industriels comprennent qu’ils risquent au contraire de perdre du terrain. Ils jouent donc la carte du local, du “ fait chez nous ”, alors que ce sont eux qui nous ont poussés vers une alimentation standardisée, au goût invariable et dépourvue d’ancrage historique réel. Les industriels misent enfin sur les arguments santé de leurs produits reformulés. La reformulation consiste à changer la recette d’un produit pour l’améliorer, par exemple en réduisant la quantité de sucre ou de gras. Mais la plupart du temps, les aliments reformulés restent ultra-transformés.
Les industriels de l’agroalimentaire développent ainsi une série de “ pratiques ” qui leur permettent de dominer le paysage international. Ceux de l’alcool, du tabac, de la pharmacie, etc. rivalisent avec eux d’habileté.
Les pratiques nocives de BigFood & Cie.
L’existence de produits malsains serait anecdotique si les industriels n’avaient pas recours à des “ pratiques nocives ” pour nous les vendre – coûte que coûte. Comme le notait Milton Friedman, les industriels existent dans le seul but de générer du profit pour leurs investisseurs. Ils sont prêts à déployer toute une panoplie de pratiques pour parvenir à leurs fins. Quoi qu’ils veuillent nous faire croire, les industriels n’ont de compte à rendre qu’à leurs actionnaires aux yeux de la loi. Qu’importe si cette course au profit est souvent incompatible avec le bien-être de la population mondiale et la protection de notre planète.
Mélissa Mialon traite précisément des pratiques commerciales, des pratiques d’entreprise et des pratiques politiques de l’industrie. Comme elle le précise, il est impossible de dresser un inventaire exhaustif de ces pratiques tant elles sont nombreuses à travers le monde et au sein des multiples secteurs industriels. Toutefois, elle présente quantité d’illustrations provenant de ses propres travaux de recherche sur l’industrie agroalimentaire. Puisque nous effectuerons ici qu’un survol de ces pratiques nocives, nous vous invitons à consulter son ouvrage pour prendre connaissance de l’ampleur et l’étendue de celles-ci.
Les industriels sont présents à nos côtés dès le berceau et même avant, puisqu’ils ciblent les futurs parents, en particulier les futurs mamans. Ils s’immiscent dans notre quotidien, jusqu’à la mort et nous y précipitent même, dans nombre de cas. En attendant, il faut que nous soyons rentables. Mélissa Mialon nous invite à poser un regard critique sur ces pratiques nocives en nous appuyant sur notre propre expérience.
Les pratiques commerciales.
Les pratiques commerciales visent le profit par la production et la vente de produits, dont les produits malsains. Ces pratiques englobent par exemple la recherche et le développement, la publicité et la distribution.
Le supermarché, ou l’expérience client programmé.
Aujourd’hui, la première source d’approvisionnement alimentaire c’est la grande distribution, autrement dit le supermarché. Le concept du supermarché a vu le jour au début du XXᵉ siècle aux États-Unis. À cette époque-là, le monde de l’entreprise est contrarié : en effet, même s’ils en ont les moyens, les Américains ne consomment pas tous les produits que les industriels ont à leur vendre. C’est de ce constat que naît l’idée de la grande surface où chaque client se rend lui-même pour s’y procurer ce dont il a besoin, parmi des centaines – voire des milliers de produits. Un siècle plus tard, au lieu de nous limiter à nos besoins prédéfinis, à des produits que nous connaissons déjà, nous sommes tentés d’en acheter de nouveaux. Sans cesse. Tout commence par la mise à disposition de charriots. Si l’on ne porte pas ses courses, elles sont moins lourdes ; la question de la nécessité d’un achat se pose donc moins qu’avec un sac qui pèse au bout des bras.
Autre stratégie : le changement incessant d’agencement du magasin. Ce n’est pas anodin : chaque fois que les rayons y changent de place ; les clients doivent le parcourir différemment afin de retrouver leurs produits habituels. Ainsi, nous passons dans de nouveaux rayons, nous y découvrons des produits que nous n’avons pas vus avant … et que nous allons peut-être acheter.
Dans un supermarché, tout est pensé pour nous faire consommer, jusqu’à la musique. Selon l’heure de la journée et la clientèle ciblée, différents styles sont diffusés pour créer une ambiance favorable à l’achat. Tout comme la musique, les odeurs sont sélectionnées puis diffusées dans le but de mettre les clients dans des conditions favorables à la consommation. Il en va de même pour les couleurs, l’éclairage ou encore la hauteur des allées. Sans que nous en soyons conscients, nos lieux d’achat sont bien plus que de simples plateformes ou nous allons nous ravitailler : ils sont pensés pour nous faire consommer.
Le marketing, ou l’art de déclencher l’envie.
Avant qu’on se rendre dans ces lieux d’achat, les industriels doivent nous donner envie d’aller y acheter. Le marketing entre alors en jeu, avec sa vaste panoplie de stratégies. Les industriels consacrent chaque année des sommes colossales au marketing. Le marketing nous pousse à consommer, y compris des produits malsains. Les populations vulnérables, dont les enfants, qui ont du mal à discerner le vrai du faux dans une publicité, ne sont pas épargnées. Une étude a montré que les enfants préfèrent manger les aliments qui leur sont présentés dans un emballage McDonald’s, plutôt que dans un emballage neutre – même s’il s’agit de carottes. Cette attirance pour une marque en particulier est soigneusement suscitée.
L’image de marque est essentielle pour l’industriel : sa marque doit véhiculer des émotions fortes, positives auxquelles les gens peuvent s’associer. Le sport, par exemple, est particulièrement visé par le marketing. Les stades et les maillots des joueurs sont donc d’excellents supports permettant d’associer une marque à des émotions positives, fortes et récurrentes. Chacun associe la marque à son club. Au-delà de la publicité dans les magazines, à la télévision, à la radio et par affichage, le marketing use de techniques de plus en plus pointues. Parmi elles, le neuro-marketing. Les industriels dépensent en effet des millions de dollars dans des appareils permettant de scanner nos cerveaux à des fins de marketing. C’est ainsi que l’industriel peut associer la consommation d’un produit avec l’activation de zones associées au plaisir pour en faire un argument de vente du genre notre produit vous rend heureux. Une autre technique récente de marketing est le jeu vidéo publicitaire. L’industriel propose un jeu vidéo, souvent gratuit et y glisse subtilement des éléments maisons : l’un de ses produits, le logo de sa marque, ses couleurs ou son jingle, par exemple. Une autre pratique de marketing : le placement de produit dans les films et les séries ou émissions télévisées. Les boissons et les aliments que les acteurs consomment sont rarement le fruit du hasard. Les industriels les fournissent aux producteurs, parfois à titre gracieux. Il ne reste plus qu’à les placer en des endroits judicieusement choisis, de manière à ce que les acteurs les dégustent tout en montrant ostensiblement la marque aux spectateurs. Ainsi le produit, en plus d’être mis en avant tel qu’il le serait dans une publicité, bénéficie du crédit et de la bonne image de l’acteur qui le consomme. Le placement de produit concerne aussi des produits bruts sains comme les fruits. Par exemple, Chiquita n’a pas besoin de promouvoir sa marque car, de toute façon, l’entreprise domine le marché de la banane. Ce fruit exotique est importé, souvent par avion et c’est sa commercialisation à grande échelle qui est mise en avant. Dans ce cas, concernant les déterminants commerciaux de la santé, on regarde au-delà du marketing, du produit sain ou pas. On s’intéresse à l’ensemble des pratiques de l’industriel, à leur impact sur notre santé et sur la planète.
Du besoin au désir selon Bernays.
Toutes ces pratiques de marketing ont vu le jour au début du XXᵉ siècle, sous l’impulsion d’Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Bernays, quant à lui, est en quelque sorte le père du marketing. Il estime que consommer pour répondre à un besoin, comme celui de manger, est insuffisant ; il faut en outre créer du désir, une envie. C’est à Bernays, par exemple, que l’on doit l’idée du petit déjeuner à l’américaine, les fameux œufs au bacon, qui n’existaient pas auparavant. Ce petit déjeuner doit non seulement nourrir, mais véhiculer l’image de la masculinité, de la richesse. Bernays est également à l’origine de la “ propagande de masse ”, une discipline ensuite rebaptisée “ relations publiques ”, mais dont les méthodes restent identiques. Les relations publiques visent à manipuler l’interlocuteur, que ce soit le public, un gouvernement ou un scientifique, par exemple. À la fin des années 1920, Bernays monte de toutes pièces un programme de soutien aux mouvements féministes américains. Il travaille alors pour les industriels du tabac, auxquels il souffle une idée. Sous prétexte de soutenir la cause des femmes, les cigarettiers proposent à celles qui défilent dans les rues de New-York d’allumer chacune une cigarette, “ torche de la liberté ”. Ce que l’histoire ne dit pas, c’est que les cigarettiers savent qu’en soutenant cette cause, ils touchent la moitié de la population, c’est-à-dire des millions de consommatrices potentielles. Associer la cigarette au féminisme et donc à la liberté, permet de conquérir toute une part de marché. C’est là une opportunité historique de vendre des cigarettes, entre autres produits non essentiels.
Les pratiques d’entreprise.
Les pratiques d’entreprise concernent le fonctionnement d’une société commerciale.
Une compétition illusoire.
Dans le cadre d’un marché économique sain, les industriels sont théoriquement en compétition, ce qui évite le contrôle abusif de ce marché par quelques entreprises seulement. Pourtant, dans de nombreux secteurs économiques, c’est loin d’être le cas. Il existe des liens étroits entre entreprises, ce qui renforce leur contrôle : aujourd’hui, des filières entières sont détenues par quelques individus seulement. Par exemple, le géant du tabac, Altria, autrefois connu sous le nom de Philip Morris, détient des parts du géant de l’alcool AB InBev, qui produit les bières Budweiser et Stella Artois. Et AB InBev fait depuis quelques années affaire avec Coca-Cola : cela permet à l’alcoolier d’élargir son réseau de distribution, tandis que le géant du soda s’ouvre un nouveau marché, celui des boissons alcoolisées. Plus les sociétés commerciales sont puissantes économiquement, plus elles ont la possibilité de racheter de plus petites entreprises et ainsi de produire en masse, à faible coût, sur tous les continents. Si les affaires ne marchent pas sur un continent, les industriels peuvent compter sur leurs filiales des pays du Sud, d’Asie et d’Amérique latine par exemple, oùla classe moyenne a de plus en plus les moyens de consommer. Ainsi, les entreprises globales écrasent petit à petit les entreprises locales, qui, elles doivent faire avec les conditions régionales et n’ont pas d’échappatoire.
Des CA omniprésents.
Les entreprises ont des liens entre elles et avec le monde politique, via leurs conseils d’administration (CA) également. Lors de ses recherches, Mélissa Mialon découvre que dans les caraïbes par exemple, les membres de conseils d’administration des géants locaux de l’agroalimentaire et de l’alcool (Demerara Distillers de Guyana, GraceKennedy Group et Lasco en Jamaïque, etc.) ont des liens avec les gouvernements, les universités, les associations et d’autres industriels et que ces liens s’étendent au-delà de la région des Caraïbes. Ainsi, à la Barbade, en Guyane, en Jamaïque et à Trinité et Tobago, plusieurs membres des CA siègent dans des associations professionnelles (représentant par exemple le secteur de l’hôtellerie et du tourisme ou celui des exports) et dans les chambres de commerce (qui réunissent et représentent les industriels) de la région, avec des banques, des compagnies d’assurance ou d’audit et de conseil. Tous ces contacts permettent de renforcer les “ connexions ” entre industriels de différents secteurs, lesquels donnent du poids auprès des instances politiques. Par exemple, en Jamaïque, un membre du CA du groupe GraceKennedy, poids lourd de la conserve et des produits laitiers, est ambassadeur du pays aux États-Unis. Un deuxième membre du même conseil est consul honoraire de Nouvelle-Zélande en Jamaïque ; il est également ministre sans portefeuille au ministère des Finances et de la Fonction publique jamaïcain et à été récemment nommé sénateur. Un troisième membre du CA du même groupe est ministre de la Formation et des Collèges et Universités, puis ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse du Canda. Certains acteurs industriels collaborent quant à eux avec des universités, comme l’université des Antilles, l’université de technologies de la Jamaïque et l’université de Guelph au Canada. De plus, elle découvre également des liens entre les membres du CA de différentes entreprises de la région et des acteurs internationaux de l’agroalimentaire, tels que Nestlé, Unilever, KFC, Starbucks et Pizza Hut.
Il est pertinent et éclairant de rapporter ici les réflexions de Alain Deneault, philosophe québécois, concernant l’activité critique des universités à l’égard des activités, pour le moins douteuses, de minières canadiennes, entre autre, sur le continent africain. Pour l’écrivain Chris Hedges, nos multiples problèmes les plus graves sont imputables à l’activité des universités, soit les “ établissements chargés de reproduire et de soutenir l’élite intellectuelle ”. Pour Hedges, la plupart des hauts lieux du savoir affichent des résultats plus que médiocres en ce qui concerne la transmission de l‘aptitude à réfléchir et à poser des questions. En fait, via diverses pratiques ; ces vénérables institutions s’affairent essentiellement à créer des hordes de “ gestionnaires compétents ”. Elles refusent de remettre en cause un système n’ayant que son propre maintien pour raison d’être. Dans ces institutions, il n’y a que l’organisation, la technologie, la promotion personnelle et les systèmes d’information qui comptent.
Cette posture de l’institution universitaire explique peut-être “ l’indifférence ” des universités pour le sort réservé au livre Noir Canada rédigé en 2008 par Alain Deneault. Cet ouvrage collige des données et témoignages produits par des sources multiples, comme des organisations civiques, des commissions parlementaires, des commissions d’enquête, des dépositions dans des procès, des documentaires, des reportages journalistiques, des livres d’investigation … C’est dans de nombreux pays, dans de nombreuses langues, dans de nombreuses sphères d’activité (journalisme, recherche, droit) qui sont étayées des allégations récurrentes dont l’ouvrage fera la synthèse : des sociétés canadiennes commettent des abus graves dans maints pays d’Afrique (pollution massive, atteinte à la santé publique, corruption, collusion avec des seigneurs de guerre, financement de dictatures, évitement fiscal…) particulièrement dans le domaine minier. Le livre se contente d’exposer un fait : l’existence de cette vaste bibliographie, qu’il produit, à propos de tant de faits allégués ! Et il tire une seule conclusion : il y a matière à enquêter du point de vue des autorités publiques, tout comme le demandent des experts mandatées par le Conseil de sécurité de l’ONU. Le style d’écriture : celui de la tradition critique, reconnue à la marge par l’institution universitaire.
Il est difficile d’exprimer en peu de mots le malaise qu’a éprouvé le milieu universitaire lorsqu’il s’est agi de se positionner quant au sort réservé à ce livre. L’institution s’est tue. C’est alors que résonne la phrase de Hedges sur les “ établissements chargés de reproduite et de soutenir l’élite intellectuelle ”. Combien de disciplines universitaires ne sont-elles pas concernées par les dossiers ouverts dans Noir Canada ? Les départements de géologie fournissent les géologues ; les facultés de droit les nombreux juristes d’entreprises et avocats en litige ; les centres de recherche en sciences économiques produiront les économistes intégrant les filières d’activité en Afrique à d’opaques modélisations de marché ; les programmes d’études en sciences comptables les petites mains ouvrant notamment des comptes dans les paradis fiscaux. Puis les écoles de commerce, elles, assurent le renouvellement d’une horde d’agents de relations publiques et en management pour assurer le fonctionnement de ces structures et de leur capitalisation boursière, notamment auprès des petits épargnants canadiens, tandis que les départements dits des “ ressources humaines ” diplôment ceux qui structureront la vie au travail. Ajoutons à ce nombre les lieux de formation de psychologues, neurologues et sociologues qui préparent également le personnel agissant dans les sphères du management et du marketing. Tous ces acteurs sociaux sont susceptibles également de travailler pour des cabinets d’influence menant de très formelles opérations de lobbying auprès des élus. Les anthropologues étudieront les populations aux abords des sites. Même des philosophes et spécialistes de l’environnement sont susceptibles de développer des programmes en “ responsabilité sociale des entreprises ”, en “ acceptabilité sociale ” et en “ éthique des affaires ”, entre autres bric-à-brac appartenant à la quincaillerie de la “ gouvernance ” pour les amener à soigner leur image. Bref, les champs de collaboration sont infinis. Et rendent donc mal à l’aise, lorsqu’on critique les bénéficiaires d’une telle pédagogie, une communauté peu habituée à mordre la main qui la nourrit. Mais cela concerne un phénomène plus large, celui de la complicité des scientifiques – lourdement tendancielle même si elle n’est heureusement pas absolue – dans les sphères d’activité échappant complètement à la vigilance critique.
“ Les universités d’élite méprisent le travail intellectuel rigoureux qui, par nature, se méfie de l’autorité, défend farouchement son indépendance et recèle un potentiel subversif. Elles fragmentent le savoir en disciplines hautement spécialisées, qui offrent des réponses pointues s’inscrivant dans des structures rigides ”, renchérit Hedges. Elles enferment trop souvent leurs pratiques dans une forme toute spécieuse de restriction mentale : la croyance entretenue voulant que l’agir scientifique se résume à un positivisme utile à la grande industrie et à la haute finance.
La fiscalité, une obligation qui se prête à “ l’optimisation ”.
La fiscalité des entreprises a, elle aussi, un impact sur la santé publique. L’évasion fiscale et/ou l’optimisation fiscale dans le jargon industriel entraîne des pertes de revenus colossales pour les États. Les industriels évitent en l’occurrence de payer leurs impôts dans les pays où ils ont leurs activités, en particulier si la fiscalité y est lourde. Les impôts tout le monde, y compris le citoyen lambda, est tenu de les payer. C’est grâce à cette contribution que nous avons un système de sécurité sociale, des écoles. Une protection minimale pour nos aînés et bien d’autres services publics. À cause de l’évasion fiscale, ce sont des milliards de dollars qui font défaut pour cet effort collectif. Pourtant, il faut savoir que les industries profitent de nombreux avantages qui n’existeraient pas sans lui : puiser dans l’eau potable pour faire tourner les usines, compter sur des employés compétents grâce au système d’éducation et en bonne santé grâce au système de Sécurité sociale, pour ne citer que ces exemples. Les industriels et les contribuables aux revenus très élevés qui ne paient pas leurs impôts ne favorisent pas ce modèle de société. Ce sont les classes ouvrières et les classes moyennes, ainsi que les petites et moyennes entreprises qui paient à leur place, puisqu’il faut bien développer les infrastructures et les services publics que nous utilisons tous – y compris les industriels.
Il faut ici rappeler l’existence de l’accord international sur le taux minimum d’imposition de 15 % sur les profits réalisés à l’étranger par les multinationales proposé par le G7 et signé, en 2021, par 130 pays membres de l’OCDE. Toutefois, de l’avis de l’ONG Oxfam France, cet accord laisse encore des failles aux multinationales pour pratiquer l’évasion fiscale.
Les conditions de travail.
Un autre point important concernant les pratiques d’entreprise réside dans les conditions de travail et la façon dont le personnel est traité. Aujourd’hui, les industriels insistent sur le fait qu’ils créent de l’emploi, en particulier, pour les femmes et en zone rurale, tout en ayant un grand respect pour leurs salariés. C’est ainsi qu’ils communiquent dans chaque rapport annuel sur ces salariés heureux de travailler pour les meilleurs entreprises du monde. En réalité, bien souvent les industriels se contentent de répondre aux exigences légales ou à la critique grandissante, concernant la place des femmes dans le monde du travail, par exemple, pour soigner leur image. Avant de faire du bien à la société, c’est donc à eux-mêmes que les progrès dont ils se flattent bénéficient – tandis que des millions de travailleurs subissent encore de nombreuses pratiques loin d’être louables. L’exposition à des produits nocifs, sur le poste de travail, rend malades quantité de salariés à travers le monde. Souvent, les industriels sont au courant et tentent de dissimuler les faits pour minimiser leur responsabilité. C’est le cas par exemple pour les pesticides.
Même les entreprises qui commercialisent des aliments plutôt bons pour la santé et non nocifs, ne sont pas forcément angéliques. Le producteur de bananes Chiquita a payé des réseaux de paramilitaires, responsables de la mort de milliers de civils dans les années 1990. Or les victimes – ouvriers agricoles sur les plantations, syndicalistes, hommes politiques et activistes – sont toutes originaires des régions productrices de bananes. Chiquita est aujourd’hui accusée devant les tribunaux d’avoir contribué à la disparition, à la torture et au meurtre de dizaines de Colombiens. Coca-Cola a financé à la même période, toujours en Colombie, le même genre de réseaux impliqués dans la mort de plusieurs syndicalistes.
Le travail des enfants représente un risque pour leur santé, mais également pour leur bien-être général. Il est interdit dans de nombreux pays. La présence d’enfants sur les chaînes de fabrication de chaussures et de ballons en Asie du Sud-Est, pour des marques comme Nike, est assez connue du grand public. On trouve aussi des enfants en Côte d’Ivoire et au Ghana, parfois dans le cadre de trafics d’êtres humains, sur les plantations de cacao ; Nestlé et Mars le transformeront en chocolat. Dans ces deux pays d’Afrique, deux millions d’enfants travaillent dans les plantations.
Or, qu’il s’agisse du financement de groupes paramilitaires, du travail des enfants ou même de fraudes, les industriels balaient les accusations, affirment mener des enquêtes sur le terrain et s’exonèrent de toute responsabilité aux dépens de quelques-uns de leurs salariés. Or quand bien même certains d’entre eux seraient fautifs, de deux choses l’une : soit les industriels ne contrôlent pas suffisamment leurs chaînes de production, soit ce contrôle est impossible tant la distance entre le siège des sociétés et les travailleurs sur le terrain est immense. Les chaînes de production et plus encore les sièges des entreprises, sont complètement déconnectés de la réalité : ou veulent nous faire croire qu’ils le sont pour mieux rejeter la faute sur les uns et les autres, sans qu’on puisse désigner un coupable ni remettre en cause le système dans son ensemble.
Les pratiques politiques.
Au-delà de ces pratiques commerciales et d’entreprise, les industriels sont des acteurs politiques très puissants, à tel point que dénoncer leurs pratiques pour améliorer la santé des populations est devenu un exercice extrêmement compliqué. En effet, les pratiques politiques des industriels sont devenues l’obstacle numéro un quand il s’agit de protéger la santé des populations. Chaque fois qu’un pays décide d’introduire une nouvelle mesure de santé publique, qui endiguerait l’épidémie industrielle, les mêmes industriels, parfois via leurs lobby ou même des groupes écrans, font tout pour empêcher ou retarder son adoption.
Influence, conflit d’intérêts, biais et corruptions : des notions bien distinctes.
Avant d’aborder ces pratiques politiques, Mélissa Mialon distingue ces termes, qui sont bien souvent utilisés de façon inappropriée.
En droit international, le “ conflit d’intérêts ” concerne une seule et même personne, ou institution (un ministère, un groupe de recherche universitaire, etc.). C’est un concept courant en particulier en politique, où le rôle des représentants est de servir le public, puisque ce sont les citoyens qui, de façon directe ou indirecte, ont élu ces représentants. Un conflit d’intérêts apparaît quand une relation ou une activité risquent de compromettre la loyauté (au public) ou le jugement indépendant de l’un de ces représentants. C’est donc une personne qui est au cœur du problème. Typiquement, l’homme politique investissant chez un fabricant de sodas aura un conflit d’intérêts s’il travaille au ministère de la Santé puisque la relation née de son investissement risque de compromettre son jugement : critiquera-t-il les sodas ou mettra-t-il en place des mesures allant à l’encontre de l’entreprise qu’il finance ?
Le conflit d’intérêts comporte un risque de “ biais ”. La décision d’investir dans les sodas constitue un conflit d’intérêts pour celui qui exerce ses fonctions au ministère de la Santé, mais ne veut pas dire pour autant que cette personne va agir de façon inadéquate par la suite. Toutefois, son jugement peut-être biaisé. C’est pourquoi la loi interdit, voire punit certains conflits d’intérêts pour éviter toute dérive. Si en revanche, la personne, parce qu’elle a cette relation ou cette activité, agit de telle façon que sa loyauté soit entamée ou que son jugement “ indépendant ” s’en trouve biaisé, alors on parle de “ corruption ”. La corruption est punie par la loi dans de nombreux pays.
Le conflit d’intérêts et la corruption sont deux concepts bien distincts quand on s’intéresse à l’influence des industriels. Alors que le conflit d’intérêts et la corruption résident chez la même personne ou au sein d’une même institution, “ l’influence ” des industriels suppose une “ relation ” : cette relation se noue entre ces industriels et un individu ou une institution. Le conflit d’intérêts, la corruption et l’influence des industriels sont tous à considérer quand on essaye de comprendre quelles relations unissent industriels et politiques, mais aussi scientifiques, médecins, etc.
Les pratiques politiques qui sont décrites par Mélissa Mialon sont toutes utilisées à des fins d’influence, mais ne font pas toutes naître un conflit d’intérêts chez les individus. Il faut aussi savoir que le risque de biais peut tenir à d’autres facteurs. Ainsi, un scientifique peut défendre une méthode de recherche qu’il préfère, préconiser un régime alimentaire, qu’il suit, ou mener des études sur une maladie en particulier parce qu’une personne de sa famille en est victime. C’est là un risque de biais pour le chercheur, mais ces éléments ne correspondent pas à la définition légale du conflit d’intérêts. Diversifier les méthodes de recherche, tester différents régimes alimentaires ou travailler sur une multitude de maladies est au contraire assez sain, puisque cela fait avancer la science et favorise le débat. Le conflit d’intérêts, la corruption et l’influence des industriels, eux, n’ont jamais qu’un seul but : servir des intérêts financiers.
Enfin, ne confondons pas non plus le conflit d’intérêts avec les “ intérêts en conflit ”. La santé publique est incompatible avec l’épidémie industrielle, elles sont en conflit, mais cela n’a rien à voir avec la définition du conflit d’intérêts, concernant une personne ou institution.
Toutefois, les pratiques politiques, directes ou indirectes, des industriels, dont l’influence mène parfois au conflit d’intérêts, puis au biais, voire à la corruption. À titre d’exemple, les documents internes (comptes-rendus de réunions, échanges d’e-mails, etc.) des cigarettiers américains qui ont été rendus publics suite à des procès gagnés par les victimes et leurs familles, confirment que ces industriels ont utilisé pendant plus de 40 années toute une panoplie de pratiques politiques visant à influencer les politiques publiques et la science, entre autres. On sait que d’autres industries – pharmacie, alcool, agroalimentaire, agrochimie – recourent à ce même genre de pratiques. La seule différence entre celle du tabac et les autres industries, c’est l’existence de millions de documents internes, qui soit dit en passant sont en libre accès via le site internet de la bibliothèque de l’université de Californie à San Francisco aux États-Unis. Pour autant, aucune incertitude ne subsiste quant à l’objectif des industriels : il s’agit de contrecarrer les objectifs de santé publique.
Mélissa Mialon regroupe les pratiques politiques des industriels en quatre grandes catégories : la gestion de coalitions, la gestion de l’information, le lobbying, le discours. Il est important de noter que ces pratiques se chevauchent parfois, car l’industriel peut poursuivre plusieurs buts à la fois.
La gestion de coalitions, ou l’art de tisser des liens.
La première pratique politique est la gestion de coalitions qui consiste à créer des liens avec différents groupes, de façon à obtenir leur soutien et leur faveur.
Des communautés comblées.
Les industriels sont très présents un peu partout dans le monde auprès des communautés, du milieu associatif. Les quelques exemples qui suivent sont alarmants, car les actions menées visent des populations vulnérables, perméables à leurs messages.
Il y a tout d’abord les banques alimentaires, qui toutes à travers le monde dépendent des dons d’aliments. La précarité des personnes qui reçoivent le don rend la question des banques alimentaires très délicate. Des milliers de personnes ne mangent pas à leur faim, alors, dans une banque alimentaire, vous prenez ce qu’on vous donne. Ainsi, les industriels distribuent leurs produits ultra-transformés et voient leurs logos affichés un peu partout, sous couvert de charité. Au Brésil, Mélissa Mialon a découvert qu’un industriel a su tirer profit d’une nouvelle gamme de produits dont le goût ne plaisait pas aux consommateurs : il a incité une municipalité à payer pour les récupérer et à les distribuer à ses habitants les plus pauvres. Au lieu de détruire sa production, l’industriel en question a gagné de l’argent avec des produits qui n’étaient pas au goût des clients fortunés, mais pourtant bons à donner aux pauvres … Pas très éthique ! En Colombie, elle a découvert l’existence d’un projet, prétendument philanthropique. Développé par un producteur de sodas colombien, propriétaire de médias et proche d’hommes politiques influents dans le pays, ce projet devait soutenir un peuple indigène pauvre et sous-alimenté dans la Guajira, département désertique du nord de la Colombie. Il s’agissait d’offrir deux boissons à des enfants de cette communauté : une boisson “ à base de fruits ” mais en réalité présents en très faible proportion et une eau minérale aromatisée. Des journalistes et militants associatifs se sont aperçu que le projet était une publicité déguisée pour ces deux nouveaux produits, avec un argument marketing massue : ils donnent de l’énergie, ils sauvent des vies ! Les enfants de cette région souffrant de la faim, les deux boissons contribuaient à les nourrir et leur faisaient prendre du poids. Mais distribuer des boissons sucrées à des populations vulnérables creuse les inégalités. Si ces populations se mettent à consommer ces boissons, elles seront plus susceptibles de développer des maladies non transmissibles. Les sortir de la pauvreté et de la faim est bien une priorité. Mais encore une fois, un industriel ne dépense pas d’argent sans attendre de bénéfice en retour.
Pour un industriel, derrière la générosité, il y a l’idée de se forger une bonne image, auprès non seulement des personnes soutenues, mais également du grand public et des instances politiques. C’est ainsi que les industriels profitent des banques alimentaires (entre autres initiatives auprès des communautés) pour lancer de nouvelles campagnes de publicité déguisées en solidarité. Liebig, par exemple, a déjà offert une soupe aux Restos du Cœur pour une soupe achetée, tandis que Modillac, fabriquant de laits infantiles, versait un euro aux Restos pour l’achat de deux produits. On vend plus, y compris des aliments ultra-transformés, mais c’est pour la bonne cause. Ces initiatives ne coûtent rien aux industriels : ce sont leurs clients qui font des dons et achètent en pensant servir une bonne cause, mais c’est leur marque qui bénéficie d’une bonne image.
Tout pour faire diversion.
Alors que les produits ultra-transformés nous rendent malades, il est pour le moins étonnant que McDonald puisse se glisser dans les hôpitaux sans être questionné sur ses intentions. En fait, plus un industriel attire l’attention sur une cause, plus il y a de raisons de penser qu’il souhaite s’en emparer pour détourner l’attention du problème de fond : les produits malsains. Ainsi, alors que l’alcool est un facteur de risque dans le développement du cancer du sein, les géants de ce secteur industriel épousent la cause et sponsorisent toutes sortes de campagnes. En France, par exemple, un vendeur de vin, surfant sur Octobre rose, incite à boire en promettant de reverser une partie du prix de ses bouteilles de rosé à des institutions telles que la Ligue contre le cancer : raison supplémentaire de consommer un produit qui pourtant aggrave la cause soi-disant défendue. Autre exemple : le financement de programme d’activité physique, très populaire chez les géants de l’agroalimentaire. Souvent, ces programmes visent une population sensible : les enfants. Les industriels du tabac, pour leur part, ont beaucoup soutenu l’art en sponsorisant musées et manifestations artistiques, en particulier aux États-Unis. Cela a donné une image de marque aux cigarettes, car l’art est souvent associé au luxe, tout en touchant les foules. Les alcooliers et les producteurs de soda, installent des stands dans les festivals de musique, ce qui leurs permettent de vendre leurs produits et de les associer à la fête et à la jeunesse.
Des médias qui s’autocensurent.
Les industriels, outre le “ secours aux communautés ” et la “ création de faux groupes de soutien ”, sont parfois très proches des médias. Avoir les journalistes de son côté peut se révéler très utile quand on veut faire passer un message ou éviter d’être critiqué. En Australie, aux États-Unis et ailleurs, les entreprises agroalimentaires invitent les journalistes à des soirées dans leurs locaux lors du lancement de nouveaux produits, ou bien les convient à des séjours tous frais payés pour discuter de différents sujets, ou participer à des conférences scientifiques. Le sujet abordé n’a guère d’importance pour l’industriel : ce qui compte, c’est la relation ainsi créée, la proximité, voire la confiance qui s’installe et la bonne image de son entreprise sera véhiculée par un journaliste. Les médias bénéficient aussi de nombreux financements grâce à la publicité, en grande partie diffusée par l’industrie agroalimentaire. À cause de cette publicité qui rapporte gros, il est malaisé de critiquer l’industrie dans les journaux ou à la télévision. Il faut dire que parfois ces médias sont détenus par des groupes qui produisent eux-mêmes des produits malsains. Rien d’étonnant donc à ce qu’ils censurent toute critique.
La gestion interne des coalitions : un pour tous.
Les coalitions se gèrent aussi en interne, parce qu’une entreprise cherche le soutien d’autres industriels. Bien que Coca-Cola et PepsiCo, par exemple, soient concurrents sur le marché des sodas, ils savent s’entendre quand certains problèmes qui concernent leur secteur les menacent.La concurrence devient alors secondaire. À plusieurs, les industriels ont davantage de moyens que s’ils affrontaient seuls une difficulté. Ensemble et organisés, ils peuvent mieux faire pression. Ainsi, Coca-Cola et PepsiCo font partie de l’Alliance internationale des aliments et des boissons créée en 2008 par les douze plus grandes entreprises de l’agroalimentaire quand certains gouvernements et l’OMS ont commencé à discuter de nouvelles lois afin de réguler l’offre alimentaire et ainsi améliorer la santé. Divers groupes interprofessionnels existent pour d’autres industries, au niveau international, régional et dans la plupart des pays du monde.
La gestion de l’opposition pour étouffer dans l’œuf la critique.
Tout ce qui est décrit précédemment concernant les communautés et leur soutien par les industriels n’empêche pas la surveillance, parfois même l’attaque de quiconque pourrait porter préjudice à telle ou telle branche de l’Industrie. Il y a tout d’abord les warrooms, ces cellules de crise aux allures de service de renseignement. Toute grande entreprise possède une cellule de ce genre, d’où elle surveille, souvent en temps réel, les faits et gestes des individus, en particulier sur les réseaux sociaux. Toute critique est ainsi détectée et identifiée comme telle sur-le-champ. Les personnes qui se préoccupent de la consommation de produits ultra-transformés et en dénoncent les effets sur la santé, tels les universitaires ou les militants associatifs, sont sous surveillance. Par exemple, au début des années 2000, Nestlé s’était infiltré dans les réunions de l’association ATTAC Suisse, qui préparait justement un livre sur les pratiques du géant de l’agroalimentaire. En surveillant l’avancement du livre, Nestlé pouvait anticiper sa défense. Parfois, les industriels demandent expressément aux professionnels de la santé publique de se taire, d’arrêter de les critiquer. Des collègues brésiliens de Mélissa Mialon ont un jour inscrit “ diabète ” sur une bouteille de soda géante. Cela n’a pas plu à l’entreprise en question, qui les a menacés d’un procès. D’autres collègues, en Colombie cette fois, ont reçu même des menaces de mort. Les industriels “ fragmentent ” enfin des groupes qui sinon seraient partenaires. Diviser pour mieux régner : l’industrie agroalimentaire, par exemple, excelle en la matière en soutenant associations et chercheurs. Elle finance notamment quantité de projets visant à promouvoir l’activité physique. Son but : montrer que le manque d’exercice a un rôle essentiel, voire plus important que l’alimentation dans l’obésité. Au lieu de tous travailler dans le même sens pour la même cause, on se retrouve avec des guerres internes. Quel est le principal facteur de risque ?
La gestion de l’information, ou l’art de brouiller les pistes.
La deuxième catégorie de pratiques politiques est la gestion de l’information. Cette catégorie fait l’objet de nombreux livres, consacrés à un secteur industriel en particulier, comme celui du tabac ou des énergies fossiles, ou bien, à l’industrie dans son ensemble.
Questionner et remettre en cause la science, débattre est sain. C’est ce qui fait avancer les connaissances. Mais pour l’industrie, le but principal n’est pas là. Bien au contraire. Les documents internes de l’industrie du tabac montrent que le “ doute ” sert en l’occurrence des intérêts financiers. La science devient un outil politique. Que se passe-t-il lorsque les entreprises financent la recherche scientifique ? Dans plusieurs domaines, l’analyse des recherches financées par l’industrie a démontré que ces dernières sont plus susceptibles de produire des résultats et des conclusions favorables au produit du sponsor que celles qui sont financées indépendamment. Comment se fait-il que l’industrie ait tendance à obtenir davantage de résultats positifs que les publications indépendantes ? Il a été démontré que celui qui finance une étude peut influencer les questions qui sont étudiées (l’agenda de recherche), les méthodes utilisées pour mener les études et enfin la publication des résultats. Par exemple, dans les années 1960 et 1970, l’industrie sucrière a parrainé un programme de recherche qui minimise le lien entre sucre et maladies cardio-vasculaires, déplaçant le blâme sur la graisse. Les entreprises ont également pour habitude de supprimer les études qui ne sont pas en faveur de leurs produits.
Pourquoi est-ce important ? En fin de compte, les entreprises financent des recherches compatibles avec leur quête de profit. Or, étant donné que la recherche sous-tend les politiques publiques, l’influence de l’industrie peut avoir un fort impact sur la santé de la population.
Création de groupes (pseudo) scientifiques : la fabrique du doute.
Tout d’abord, les industriels créent des groupes scientifiques qui semblent indépendants, mais ici à des fins d’influence de la science et de l’information. Il existe de tels groupes dans plusieurs industries. L’exemple le plus connu est celui de l’industrie du tabac, qui a su très tôt que ses produits étaient dangereux pour la santé. Ainsi, dans les années 1950, les industries de la cigarette, en réponse aux premières publications montrant que le tabagisme favorise le cancer du poumon, créent leur Comité de recherche de l’industrie du tabac. Il aurait été trop risqué d’affirmer que les nouvelles connaissances sur le cancer étaient complètement fausses. Ce qu’il fallait faire, c’était de semer le doute. Les industriels, quels qu’ils soient, cherchent à contrôler l’information avant que les experts de la santé publique et les autorités ne le fassent. Donc, quand ils ont compris qu’une question de santé liée au tabagisme allait bientôt se poser, les cigarettiers ont feint de la prendre à cœur. La mission officielle du Comité de recherche sur le tabac était, à sa création, de faire avancer la science quant aux liens entre tabac et santé. Au bout d’une dizaine d’années, le Comité de recherche sur le tabac a été rebaptisé Conseil de recherche sur le tabac. En fin de compte, c’est la recherche en général et pas du tout celle sur la cigarette en particulier, que ce Conseil a financé. Cela a permis de détourner l’attention de la question du cancer causé par la cigarette, tout en laissant penser que quelqu’un s’en occupait. Les industriels du tabac ont par exemple investi dans la recherche sur l’amiante et la santé. Oui, en effet, l’impact de l’amiante sur la santé est un domaine de recherche qui mérite d’être financé, mais l’intention des cigarettiers est alors de critiquer un autre produit que le leur – pas de favoriser la santé publique.
Les industriels du sucre ont fait de même en finançant des recherches via la Fondation de recherche sur le sucre. Ces recherches visaient à incriminer d’autres facteurs que le sucre dans le développement des maladies non transmissibles et des caries. Ainsi, au lieu de parler du rôle du sucre dans le développement de maladies cardiaques, les industriels ont attiré l’attention sur celui du gras, entre autres. Pour ce qui concerne les caries, ils ont tout fait pour éviter une discussion sur le sucre et ont longtemps parlé du fluor, de la nécessité de se laver les dents. De quoi détourner l’attention et de consacrer les financements à autre chose.
Autre exemple connu dans l’industrie agroalimentaire : l’Institut international de la science du vivant (ILSI). L’ILSI a vu le jour à la fin des années 1970 et à l’heure actuelle, ses différentes branches à travers le monde (une quinzaine) sont toutes financées par des industriels de l’agroalimentaire et de la pharmacie parmi tant d’autres. Dans de nombreux pays, des études ont montré que l’ILSI cherche avant tout à défendre les industriels qui le soutiennent par des activités scientifiques mais aussi politiques. L’Institut organise par exemple de nombreux séminaires sur les avantages des édulcorants, les risques liés au manque d’activité physique, ou encore sur le rôle primordial du partenariat privé-public pour améliorer la santé des populations, cela sans être très clair sur les liens avec les industriels. Mélissa Mialon et des collègues ont démontré dans un article paru en 2021, documents internes à l’appui, que l’ILSI a noué de nombreux liens avec des chercheurs et des instances de santé aux États-Unis et à travers le monde. Son but : inciter les scientifiques et le public à revoir leur conception du conflit d’intérêts, à poser un nouveau regard sur les problèmes liés à l’influence des industriels en science et en politique ainsi que sur leurs solutions. L’influence de l’ILSI ne concerne ainsi plus seulement la nutrition et l’activité physique : l’Institut cherche carrément à influencer les principes même de la science.
Production de nouveaux savoirs en externe, ou comment soigner sa crédibilité.
Les industriels financent aussi des chercheurs universitaires pour des projets ou études spécifiques ; cela se fait de manière plus ou moins transparente. Pour un industriel, il est toujours plus crédible de faire référence à une étude menée par un chercheur reconnu dans son domaine que publiée par lui-même. Mélissa Mialon et des collègues ont montré que dans les revues scientifiques les plus prestigieuses en nutrition, 13 % des articles publiés émanent de l’industrie agroalimentaire, via le financement ou la participation d’auteurs employés par des entreprises du secteur, par exemple. C’est dire l’importance du problème… Cependant, les recherches réalisées en externe ne sont pas toutes publiées dans des revues scientifiques prestigieuses : parfois, il s’agit juste d’éditer une jolie brochure soulignant le travail édifiant d’un scientifique, qui sera distribuée à nos politiques. Certaines études paraissent quant à elles dans des publications scientifiques connues pour être de mauvaise qualité. Tout cela crée et entretient la confusion. Nos décideurs ne sont pas tous des scientifiques ; ils ne sont pas toujours attentifs aux sources de financement ni n’évaluent de façon rigoureuse la qualité de l’information. Alors ce qui compte pour les industriels, c’est que l’information ressemble à de la science.
Les industriels financent également des études qui vont promouvoir leurs aliments ultra-transformés. Mélissa Mialon et des collaborateurs ont montré que Nestlé finance l’une des plus grosses études sur l’alimentation des bébés et leur état de santé menée aux États-Unis. Cette étude, en cours depuis 2002, montre que les nourrissons et les jeunes enfants sont carencés en certains minéraux. Or Nestlé (parmi d’autres) propose justement des aliments enrichis en ces minéraux – qui peuvent donc répondre aux besoins ! Cette étude, l’une des seules de cette ampleur sur le sujet, a été reprise par l’Académie américaine de pédiatrie dans ses recommandations alimentaires : il fallait tel ou tel minéral dans l’alimentation du bébé ; c’était un impératif national. C’est ainsi que Nestlé a pu avancer dans ses publicités que ses aliments enrichis en minéraux répondaient justement aux recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie.
Il va de soi que ce genre d’étude ne pose pas la question de l’influence des produits ultra-transformés sur la santé. Quant est-il du lait maternel comparé au lait infantile, l’un des produits phares de Nestlé ? La composition du lait maternel change à chaque tétée, selon ce que la maman mange et même pour répondre aux besoins immédiats de l’enfant. Il est malade ? Sa maman va produire des anticorps spécifiques. Pourtant, il est impossible pour une maman de connaître la composition de son lait, qui plus est en temps réel. Les laits infantiles quant à eux, sont standardisés, donc le consommateur dispose de l’information. En suscitant le doute puis l’angoisse avec leurs études relayées par les instances nationales, en montrant que la population est carencée, les industriels et leurs produits, apparaissent comme la solution la plus simple, la plus rassurante : “ je sais exactement ce qu’il y a dans l’aliment que j’achète, ça me donne confiance ”. Cela perpétue l’idée que les produits industriels, y compris les ultra-transformés, sont la seule solution – alors qu’ils sont l’origine indéniable du problème !
Le ghostwriting, c’est-à-dire le fait pour quelqu’un de contribuer à l’écriture d’un article scientifique sans figurer sur la liste des auteurs, est un autre problème majeur quand il est question d’industriels, de science et de santé. Par exemple, Merck, l’entreprise pharmacologique, publie entre 1996 et 2004 un total de 96 articles sur son médicament Vioxx. Le nom de l’entreprise apparaît dans la plupart des articles concernant les études cliniques, mais dans les revues qui résument la littérature sur le sujet, le rôle de Merck n’est cité que dans la moitié des cas ; dans l’autre moitié, seuls des chercheurs, payés par Merck, signent les articles scientifiques de leurs noms. Le renom d’un scientifique est crucial pour l’industrie, car si le chercheur est respecté dans son domaine, l’article ne sera pas forcément critiqué comme il aurait pu l’être si c’était l’industrie qui l’avait publié elle-même. Ainsi, l’industrie publie des études qui louent ses produits. Mais, l’un des problèmes concernant Merck et le Vioxx est que les données furent présentées de façon à minimiser les risques cardio-vasculaires induits par la prise du médicament. On a donc longtemps ignoré les dangers du Vioxx – alors que Merck était au courant. Le médicament a été retiré du marché américain en 2004, après avoir causé plus de 30,000 accidents cardiaques dans le pays. Parfois, les scientifiques n’ont jamais accès aux données. Quand un auteur, sans avoir participé à une étude ou à l’écriture d’un article, figure quand même parmi les auteurs, on appelle cela du ghost authorship. Les scientifiques concernés, qui ont besoin de publier pour soigner leur réputation, acceptent d’associer leur nom à ces publications – et ils sont même payés pour le faire par les industriels, de la pharmacie entre autres.
Mélissa Mialon prend soin de préciser que la recherche scientifique financée par l’industrie n’est pas forcément de mauvaise qualité. Les recherches ne sont pas non plus manipulées dans tous les cas. Les chercheurs qui reçoivent des financements de l’industrie n’ont pas non plus nécessairement l’intention de promouvoir un secteur industriel, ni tel ou tel produit. De nombreuses recherches sont très bien menées, par des groupes de chercheurs respectables. Mais certains d’entre eux, n’étaient pas au courant que des groupes interprofessionnels tels que l’Institut international de la science du vivant, étaient montés de toutes pièces par les industriels. Un financement alloué par le Conseil pour la recherche sur le tabac ne révèle rien du lien que cet organisme a avec l’industrie de la cigarette. Si certains chercheurs ne soupçonnent pas encore l’influence que les industriels ont sur la science, d’autres décident de se consacrer à une recherche orientée vers le profit, vers ce qui rapportera aux industriels et donc continuera à financer la recherche ainsi. Enfin, les industriels investissent dans des causes très louables, comme l’activité physique, mais détournent l’attention de sujets embarrassants pour eux. C’est leur capacité a axé la recherche sur des questions présentant un intérêt pour eux seuls, qu’il s’agisse de mieux vendre leurs produits ou de taire un risque lié à leur consommation, qui est problématique.
Déstabilisation de la recherche et des chercheurs.
L’industrie soutient la publication de recherches et d’informations propres à créer du doute dès que ses produits sont remis en cause du point de vue de la santé publique. Les industriels sont aussi très réactifs quand il s’agit de remettre en cause les études qui ne leur conviennent pas. Cela peut passer par la critique du travail scientifique lui-même, comme ce fut le cas pour des collègues à Mélissa Mialon s’intéressant à l’incidence de l’alcool sur la santé : ils ont vu leur travail attaqué par un non-expert, via un commentaire dans un journal scientifique. Pour le lecteur qui n’est pas du sérail, cette critique peut paraître valide. Au Chili, une entreprise de l’industrie agroalimentaire a demandé à des chercheurs qu’elle finançait de falsifier les données récoltées parce que les résultats ne lui plaisaient pas. Des propositions d’emploi peuvent être faites, de la part de l’industrie agroalimentaire, à un chercheur qui a commencé à publier trop de résultats défavorable à cette industrie. Plutôt que de s’opposer au travail de ce chercheur, mieux vaut qu’il travaille pour l’industrie : cette pratique, la cooptation, consiste à faire venir vers vous quelqu’un de l’extérieur. Des réseaux de chercheurs très liés à l’industrie agroalimentaire existent au Brésil, aux États-Unis et en France.
Par ailleurs, les industriels surveillent les chercheurs qui risquent de leur poser problème. Parfois cela prend d’autres proportions. Au Mexique, l’un des premiers pays au monde a avoir tenté d’instaurer une taxe sur les sodas dans un contexte d’obésité alarmante de la population, des chercheurs se sont aperçus que leurs téléphones portables avaient été piratés. Ils ont reçu des textos contenant des photos de cercueils pour leurs enfants – autant dire des menaces de mort… Après enquête, il s’est avéré que c’est le gouvernement mexicain qui, avait demandé à une société israélienne d’installer un logiciel malveillant et d’espionner le travail des collègues de Mélissa Mialon travaillant sur l’alimentation. Or on sait que le gouvernement mexicain est très proche des industriels de l’agroalimentaire ; Vincente Fox, l’ancien président de la République de 2000 2006, a longtemps travaillé chez Coca-Cola. L’instauration d’une taxe au Mexique aurait pu donner des idées dans les pays d’Amérique du Sud, gigantesque marché pour le numéro un du soda, d’où l’urgence de dissuader les chercheurs.
Divulgation de la science et de l’information : l’industrie tient les rênes.
Pour faire en sorte que la science qu’ils soutiennent soit divulguée au plus grand nombre, les industriels sont largement présents lors des conférences scientifiques. Ils organisent leurs propres événements, souvent via leurs groupes interprofessionnels. Les industriels de la bière organisent régulièrement leur symposium “ Bière et Santé ” ; ceux du sucre, des événements sur le sucre et la santé. En Amérique latine, Mélissa Mialon et des collaborateurs ont montré que 92 entreprises du secteur agroalimentaire sponsorisent 88 % des événements scientifiques consacrés à la nutrition et à la diététique du continent. Elles sont partout, aux côtés des industriels de la pharmacie, bien souvent. Le sponsoring peut concerner des conférences ou des sessions à thème (santé du microbiote, importance de l’hydratation) ; le lien avec l’industrie des intervenants n’est pas toujours mentionné. Par exemple, aux États-Unis, l’industrie du tabac employait à une époque des chercheurs influents pour des roadshows scientifiques. Le but de ces tournées : discréditer les nouvelles données sur le tabac et la santé. Ces scientifiques servaient en quelque sorte de porte-parole à l’industrie, sans que les industriels aient besoin d’assumer leur attaque de la science. On crée ainsi de la confusion en donnant l’impression que ce sont des scientifiques indépendants qui se positionnent sur un sujet de santé.
Tissage de liens : qu’il fait bon s’entendre avec les institutions scientifiques, médicales et les gouvernements.
Un exemple d’association professionnelle avec laquelle les industriels ont tissé des liens : l’Union française pour la santé bucco-dentaire, partenaire d’entreprises comme Cadbury. Or, l’Union encourage sur son site Internet à mâcher des chewings-gums sans sucre (l’un des produits vendus par Cadbury, justement), solution pour une bonne hygiène buccale.L’Union est également soutenue par les industriels de la pâte dentifrice, dont Colgate. C’est une manne incroyable pour les industriels, car l’Union promeut leurs produits, qui trouvent une place dans le discours médical, atout incomparable en matière de crédibilité.
Indépendants, les professionnels de santé ?
En Afrique du Sud, Nestlé et le lobby du sucre sponsorisent la formation continue des diététiciens et nutritionnistes. Nombreuses sont les associations de nutrition et de diététique, mais aussi de pédiatres par exemple, qui organisent des sessions d’information pour leurs membres adhérents grâce au soutien financier et/ou logistique des industriels de l’agroalimentaire. C’est le cas en Australie, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Colombie et certainement dans la plupart des pays du monde. Une étude a montré que 60 % des associations de pédiatres dans le monde reçoivent un soutien financier de la part des industriels du lait infantile ; ce pourcentage est sans doute sous-estimé, car ces associations ne sont pas forcément transparentes quant à leurs relations avec les industriels.
Concernant les liens des industriels avec les gouvernements, il existe un cas typique en France : la Semaine du Goût. C’est le CDUS, devenu Cultures Sucre, qui se cachait derrière cet événement depuis sa création, avant qu’il le cède à une agence de communication qui compte de nombreux industriels de l’agroalimentaire parmi ses clients. En 2013, l’Éducation nationale signe même un accord avec l’organisation interprofessionnelle pour une durée de cinq ans. Sa mission : mettre en place des activités sur l’alimentation dans les écoles. L’industrie du sucre est donc officiellement chargée d’apprendre aux élèves français ce qu’il faut manger, ce qui est “ bon ” et ce qui est “ mauvais ”.
La science versus l’information.
Parfois, l’information peut avoir l’odeur de la science, mais pas le goût. Il ne s’agit pas toujours de payer des études ou des chercheurs, mais d’accaparer un sujet pour en devenir la source principale d’information. Par exemple, Mead Johnson, fabricant de laits infantiles, est derrière le site https://www.allergieaulaitdevache.fr
, qui, comme son nom l’indique, fournit des informations sur les allergies au lait de vache chez les jeunes enfants. Il faut consulter les mentions légales pour découvrir qu’il est géré par l’entreprise américaine. Évidemment, en naviguant sur le site, on tombe rapidement sur des préconisations présentant les laits infantiles comme l’une des principales solutions aux allergies. Une diététicienne (de chez Mead Johnson, mais personne ne s’en rend compte) et un numéro vert sont même à la disposition des visiteurs. Ferrero, dont le Nutella est de plus en plus controversé en raison de son impact sur notre santé et la planète, s’est appuyé en 2018 sur le crédit dont jouit naturellement une diététicienne pour expliquer au public que sa pâte à tartiner avait “ toute sa place au petit déjeuner, dans le cadre d’une alimentation équilibrée ”. Ici, la notion d’équilibre dans l’alimentation est détournée. En effet, quand on parle d’équilibre dans l’alimentation on entend par là l’association de différents aliments “ sains ”, comme le prescrivent les recommandations françaises, par exemple. Il ne s’agit en aucun cas d’un équilibre entre aliments sains et aliments ultra-transformés. Mais les industriels se sont emparés de cette notion d’équilibre et l’ont revue “ à leur sauce ”. Ils tiennent un discours de santé pour mieux détourner cette notion et en profiter pour vendre leurs produits ultra-transformés.
L’éducation a bon dos.
Mélissa Mialon et des collaborateurs ont réalisé que des campagnes de distribution d’aliments ultra-transformés, au petit déjeuner et à d’autres repas, étaient organisées en Afrique du Sud et dans plusieurs pays d’Amérique latine, sous prétexte d’éducation à l’alimentation. Une façon de faire oublier le rôle de ces aliments dans la dégradation de la santé, tout en faisant du marketing (pratique commerciale) et en influençant les communautés (gestion de coalitions). Ce genre de programmes de distribution alimentaire est parfois le résultat de collaborations avec les gouvernements. C’est le cas en Colombie, où les municipalités distribuent des produits industriels en partenariat avec les transformateurs de lait. Les documents internes de l’industrie du tabac ont montré que la “ prévention ” dans les écoles sert en fait de porte d’entrée dans des lieux inaccessibles autrement. Une couleur rappelant la marque, un logo apposé sur un petit livret sympa suffiraient pour que les enfants choisissent ce produit plutôt qu’un autre quand viennent l’heure et l’âge de consommer. Et évidement, plus tôt les industriels approchent les enfants, plus ils ont de chance de s’immiscer dans leur quotidien et de banaliser la consommation de leurs produits. Les questions abordées par les industriels peuvent être importantes, mais ici l’argent est investi pour détourner l’attention des problèmes de santé publique majeurs et des causes profondes de ces problèmes, dont l’existence de produits malsains. Intégrer et soutenir des groupes interprofessionnels de santé, que l’on soit scientifique, professionnel de la santé ou professeur des écoles, c’est donner à son insu une crédibilité non négligeable à l’industrie.
Le cas particulier des médicaments.
La gestion de l’information comprend aussi les recherches obligatoirement menées par les fabricants de certains produits, tels les médicaments, pour montrer qu’ils sont inoffensifs. Cette mission est en effet confiée aux entreprises elles-mêmes. Le principal problème est que les industriels du médicament ont tout intérêt à dire que leur produit est inoffensif ; logique quand le but est de le mettre sur le marché, puis de le vendre. Alors les expérimentations réalisées par les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas toujours solides ni transparentes : elles sont rarement assez longues pour garantir que personne ne développe aucun symptôme après avoir pris le médicament proposé. Et que dire des études dont les résultats sont passés sous silence quand ils montrent qu’un produit est dangereux ! Contrairement aux études menées par les universitaires indépendants, elles n’ont pas à être publiées ! C’est ainsi que l’on découvre le manque d’efficacité ou les effets secondaires de certains médicaments des années seulement après leur mise sur le marché.
Le lobbying et autres formes d’influence directe.
Quand on parle pratiques politiques et influence des industriels, le lobbying est certainement ce qui nous vient d’abord à l’esprit. Pourtant, les industriels peuvent influencer nos responsables politiques et les décisions de santé publique de multiples façons. Évidement, influencer les lois est le but ultime. En effet, c’est la loi qui décide de la façon dont un industriel va se comporter dans un pays, de ce qu’il aura le droit de faire ou on. Le but de l’industriel est donc : d’empêcher l’adoption de certaines lois contraignantes ; d’en retarder l’application ou de les affaiblir ; ou bien, au contraire de faire en sorte que celles qui profitent à l’industrie entrent rapidement en vigueur.
Mélissa Mialon prend soin de préciser que le lobbying n’est pas le problème en soi. D’ailleurs, il ne s’agit pas d’une pratique propre à l’industrie ; n’importe quelle personne, n’importe quel groupe qui souhaite promouvoir ses intérêts peut y recourir. Le problème réside dans le fait que les industriels ont beaucoup plus de moyens que n’importe quel individu, n’importe quelle association et peuvent donc décupler leurs efforts de lobbying au quotidien, jusqu’à obtenir une loi en leur faveur. Avec plus de 4 millions d’euros dépensés chaque année, Shell figure parmi les cinq entreprises qui investissent le plus en matière de lobbying auprès de l’Union européenne. Les quatre autres championnes du top cinq sont Bayer (qui a racheté Monsanto en 2016) et les trois géants du Web : Google, Microsoft et Facebook (devenu Meta en 2021).
Des bataillons de lobbyistes ou représentants d’intérêts dans leur jargon, ont un accès officiel auprès de nos décideurs politiques au niveau national, à des cercles où beaucoup de décisions se prennent. Par exemple, entre 2018 et 2020, l’Association nationale des industries alimentaires intervient trente fois auprès de nos responsables politiques et dépense en lobbying entre 300 000 et 400 000 euros en 2019. Deux de ses objectifs (parmi d’autres) sont clairs : “ défendre la position de l’industrie alimentaire française ”, en l’occurrence contre une proposition de taxe sur le plastique en Europe et s’opposer aux propositions concernant l’étiquetage des aliments. En effet, aujourd’hui, le Nutri-Score est adopté en France, même s’il n’est pas obligatoire. Mais pour l’Association nationale des industries alimentaires, la bataille continue au niveau de l’Union européenne.
Le registre des lobbyistes tenu pas la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, nous apprend, par exemple, que Bayer intervient en 2018-2019 auprès de nos représentants socio-économiques pour “ sensibiliser les pouvoirs publics aux conséquences socio-économiques de l’interdiction de certains produits phytosanitaires ”. Dit plus simplement, Bayer entend les persuader que l’interdiction des pesticides aurait des conséquences néfastes sur notre société et notre économie. Bayer peut alors compter sur le soutien du Syndicat national Fabric sucre qui demande de son côté “ la reconnaissance de la spécificité de la culture de la betterave sucrière dans le cadre de l’interdiction des néonicotinoïdes ”. En d’autres termes, l’industrie du sucre souhaite continuer à utiliser certains pesticides. Deux industries, une cause commune. Les informations fournies par le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique nous permettent de constater que la “ gestion de l’information ” contribue au lobbying. Ainsi, sur la même période, Coca-Cola soulignait ses “ engagements en matière de nutrition/santé, d’information du consommateur et de marketing publicitaire ”. Le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière, parmi ses douze interventions la même année, à quant a lui proposé aux pouvoirs publics “ la mise en place d’une politique publique de sensibilisation du petit déjeuner dans les collèges de France (Comité du petit déjeuner à la française) ”, et consacre chaque année entre 300 000 et 400 000 euros au lobbying.
Ce ne sont pas toujours les industriels eux-mêmes, ni leurs représentants comme l’Association nationale des industries alimentaires, Cultures Sucre ou le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière qui font du lobbying. Parfois, ils confient cette tâche à des cabinets de relations publiques. Red Bull (boisson énergisante), par exemple, en plus d’exercer son propre lobbying, est client du cabinet Burson Cohn & Wolfe, chargé de “ présenter l’engagement de Red Bull en faveur du sport et de la culture ”.
Il existe par ailleurs dans de nombreux pays des lobbys un peu plus informels, appelés clubs parlementaires. Ils réunissent des députés autour de causes qui leur tiennent à cœur. Ils organisent des débats, publient des journaux et orchestrent des évènements internes à l’Assemblée nationale. Nous avons ainsi en France l’Association nationale des élus de la vigne et du vin. Cette association représente bien un secteur industriel, mais ce sont nos représentants et décideurs politiques qui en sont les porte-parole, sans que l’industrie fasse forcément pression sur eux : l’industrie du vin a un tel poids économique et culturel en France, que les politiques se mobilisent spontanément en sa faveur. À la différence de ce qui existe en Irlande et en Angleterre, nous n’avons pas en France de registre officiel des clubs parlementaires, dont l’activité réelle est donc difficile à cerner.
Les incitations financières : des cadeaux intéressés.
Autre forme d’influence politique : les incitations financières. En l’occurrence, les industriels donnent de l’argent ou font des dons, dans l’espoir évidemment que ces cadeaux incitent les décideurs politiques à soutenir leurs causes. Ces incitations peuvent prendre la forme de dons financiers aux partis politiques et aux décideurs eux-mêmes. Certains cadeaux, à défaut de pouvoir être faits à une personne en particulier, sont reçus officiellement par le gouvernement, ce qui n’empêche pas que le cadeau est fait.
Nous sommes une espèce sociale. Le cadeau de tout temps, a eu un rôle signifiant dans nos relations avec les autres. Il s’installe inconsciemment quand on le reçoit un besoin de réciprocité : on devient redevable à l’autre. Un décideur politique comblé est beaucoup moins enclin à voter des lois trop contraignantes ; il peut même proposer des lois qui vont aider ses donateurs. Cette observation vaut bien entendu pour toutes les pratiques politiques abordées jusqu’ici : influence des communautés, financement des associations de professionnels de la santé, etc. En Colombie, par exemple, le président qui a gagné les élections en 2018 a reçu 148 000 dollars américains de la part de l’industrie des sodas. Évidement, une fois en fonction, il s’est positionné contre les mesures de santé publique susceptibles de plomber les ventes de ces produits (taxe sur les sodas, étiquetage). Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, les industriels ne donnent pas forcément davantage aux partis plus libéraux, de droite, qu’aux partis plus socialiste, de gauche. En Australie, Mélissa Mialon et des collaborateurs ont observé en 2014 que Coca-Cola, par exemple, donnait la même somme aux deux camps. Il s’agit de faire en sorte d’avoir les politiques de son côté, car n’importe lequel est un jour susceptible d’être élu.
En Amérique du Sud et dans d’autres régions du monde, Nestlé, par exemple, offre des cafetières de sa marque aux bureaux des politiques et de leurs équipes. Des cadeaux de Noël en tout genre sont distribués chaque année dans les pays où Mélissa Mialon a travaillé, dont l’Australie, la Colombie et le Brésil. En Colombie, les industriels offrent des bourses d’études dans de prestigieuses universités étrangères aux enfants des députés, à condition bien sûr que ces députés votent en leur faveur.
Le pantouflage, propice à l’influence ?
Le pantouflage consiste pour un ministre, par exemple, à aller travailler au sein d’une entreprise qu’il régulait auparavant en raison de ses fonctions. Ainsi, lorsqu’il abandonne son rôle au gouvernement, le politique possède un carnet d’adresses prestigieux et des connaissances sur les rouages de l’administration – autant d’avantages non négligeables pour son nouvel employeur. À l’inverse, certains industriels intègrent le gouvernement. Dans ce cas, leurs anciens employeurs bénéficient d’un accès direct à quelqu’un qui travaille désormais en politique. Le pantouflage est soumis dans certains pays à une période transitoire d’une à trois, voire cinq années, pendant laquelle il est impossible de passer de la fonction publique à un travail dans une entreprise dont on avait la charge. Il existe d’ailleurs l’équivalent concernant les mouvements à l’intérieur d’un même secteur industriel : pour se protéger de leurs concurrents, les patrons incluent souvent des clauses de confidentialité et de non-concurrence dans les contrats de leurs salariés. En France, par exemple, Édouard Philippe, ancien Premier ministre, a été lobbyiste pour Areva, entreprise spécialisée dans l’énergie nucléaire, alors qu’il était en même temps adjoint au maire du Havre et conseiller général de Seine-Maritime. Par la suite, en tant que député, il a voté contre les projets de loi sur la transition énergétique et la biodiversité. Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, a quant à elle reçu en tant que chercheuse des financements de l’industrie pharmaceutique avant de prendre ses fonctions au gouvernement. Ces relations ne veulent pas dire que le responsable politique prendra forcément des décisions biaisées en faveur des industriels, mais ses anciens employeurs industriels peuvent à tout le moins avoir facilement accès à lui.
Co- et autorégulation : du partenariat au volontariat.
Les industriels, en particulier ceux qui vendent des produits malsains, n’apprécient guère les mesures de santé publique. Ils luttent contre leur mise en application aux quatre coins du monde. Or, la solution pour les retarder est de recourir à la co- ou à l’autorégulation. La corégulation consiste en la mise en place d’un accord entre un gouvernement et des industriels, dans le cadre duquel ces derniers s’engagent à prendre certaines mesures, mais sans y être contraints par la loi. Ce genre de partenariat a bourgeonné au début des années 2000 au niveau international, quand l’OMS et d’autres agences onusiennes ont préconisé l’implication des industriels dans les programmes de santé publique. Le Royaume-Uni a servi de modèle pour la corégulation des activités de l’industrie agroalimentaire et de l’alcool. Avec le recul, la corégulation s’avère moins efficace que la loi : pas les mêmes critères, pas d’obligation, moins de contrôles, peu de sanctions. Ceci explique cela. Prenons comme exemple la reformulation des produits ultra-transformés par les industriels, le changement de recette. On prend l’ancien produit, on remplace quelques ingrédients et nous voilà avec un produit “ reformulé ”. Grâce à la corégulation, les industriels jouissent du crédit que leur confère la confiance accordée par les gouvernements, en tant que partenaires officiels. Ils peuvent ainsi montrer qu’ils sont “ engagés ” à leurs côtés, qu’ils agissent en faveur de la santé – alors qu’en réalité ils ont souvent bataillé pour qu’une loi, plus contraignante, ne voit surtout pas le jour.
De la corégulation à la coréflexion.
Il y a des situations un peu hybrides, de corégulation tout de même, où un gouvernement s’empare d’un sujet, puis invite à la réflexion à ses côtés différents acteurs, y compris industriels. Par exemple, il existe en France le Conseil national de l’alimentation, une “ instance consultative indépendante ”, placée auprès des ministres chargés de l’environnement, de la consommation, de la santé et de l’agriculture. On y trouve des membres du gouvernement, des experts scientifiques parmi lesquels on retrouve des personnes qualifiées proches des industriels, des membres de la société civile et des industriels de l’agroalimentaire. Au Conseil national de l’alimentation, il est bien question de santé, comme en témoignent des rapports sur “ l’éducation à l’alimentation ” ou “ l’alimentation favorable à la santé ”. Dans ce dernier rapport, on apprend qu’il n’existe aucun consensus au sein du Conseil national de l’alimentation quant au besoin de réguler l’offre alimentaire et en particulier que la Fédération du commerce et de la distribution ne soutient pas l’idée de limiter le marketing. Pour les industriels, un tel conseil est un outil parfait : il leur permet d’influencer les autres participants, d’éviter les mesures trop drastiques et contraignantes et de se forger une bonne image auprès des décideurs comme du public tout en côtoyant plusieurs scientifiques respectés dans leur domaine.
Une étude récente a montré que dans le cadre de ce genre de relation, le gouvernement manque d’informations : il compte sur la bonne volonté des industriels pour lui fournir celles concernant leurs produits. En effet, pour vérifier que les industriels améliorent bien leurs aliments, un gouvernement a besoin d’informations de leur part, de leur collaboration. La même étude a mis en évidence un autre phénomène : quand un industriel partage des informations qu’un gouvernement n’a pas, c’est un peu un cadeau qu’il lui fait comme en cas d’incitation financière. Dans le cadre de cette relation, le gouvernement a besoin de l’industrie et l’industrie peut jouer de son pouvoir. Enfin, le gouvernement n’a aucun intérêt à dire que la corégulation n’a pas fonctionné, que les industriels n’ont pas répondu aux exigences, parce que ce serait alors un aveu d’échec. Souvent, ce genre de partenariat est donc présenté de façon très flatteuse, même si des études indépendantes montrent qu’ils sont au mieux inefficaces.
Consommez bonnes gens, on progresse !
Un secteur industriel promet de prendre lui-même des mesures, sans qu’un gouvernement ait besoin d’intervenir. On parle alors d’autorégulation. Souvent, seuls quelques industriels s’engagent, sans la moindre obligation : tout repose sur le volontariat. Ils ont alors généralement quelques années devant eux avant que leurs efforts et l’efficacité des mesures qu’ils ont proposées soient évalués. Plus encore qu’en cas de corégulation, les mesures choisies par les industriels, n’ont pas le caractère contraignant que pourraient avoir des lois. Dans quelques pays, par exemple, les entreprises de l’agroalimentaire s’engagent à ne pas faire de publicité pour les produits malsains à l’heure oùles enfants regardent des dessins animés ; mais les spots vantent des produits “ plus sains ” ou “ sains ” – selon les critères des industriels – abondent à leur place. Outre le fait que ces aliments “ plus sains ” peuvent toujours être ultra-transformés, l’enfant reconnait le logo de la marque ou son univers.
Quand il s’agit d’innover soi-disant en faveur de la santé, les industriels ne sont pas à court d’idées : pour preuve les yaourts allégés. Pour diminuer la teneur en gras de leurs laitages et donc en faire des yaourts “ allégés ” tout en préservant la texture du produit, ils ajoutent de l’amidon, qui est un sucre ! Donc, on allège d’un côté, pour alourdir de l’autre. On reste dans l’ultra-transformé mais, dans le discours, le produit a été amélioré en pensant à la santé du consommateur.
Pendant ce temps-là, nos gouvernements et les Nations unies applaudissent chaque petite avancée, invitent les industriels à la table des décisions – alors que sans eux, la santé publique serait amplement préservée. Et plus, d’ailleurs, modifier un produit ne fait pas disparaître les autres pratiques nocives des industriels.
Les instances supérieures à la rescousse des industriels.
L’Union européenne, tout comme les instances des Nations unies et autres plateformes internationales pour les décisions commerciales est devenue clé pour les industriels, qu’ils soient dans l’alimentation, l’alcool, la cigarette, la pharmacie ou autre secteur. Quand une loi risque d’être adoptée au niveau national, les industriels visent alors plus haut, au niveau de l’Union européenne, afin que les décisions prises dans un pays y soient bloquées. C’est ce qu’on appelle le “ changement de lieu ”. Cela s’est produit quand le gouvernement écossais a voulu taxer les boissons alcoolisées il y a quelques années : outre la pression exercée en Écosse, les alcooliers sont allés frapper à la porte de l’Union européenne, espérant y trouver du soutien. En vain cette fois, puisque la taxe a finalement été instaurée en Écosse.
L’Organisation mondiale du commerce a un rôle majeur à jouer concernant les industriels et la santé, comme le montrent les exemples qui suivent. Les industriels néo-zélandais de la viande ont longtemps vendu des carcasses de mouton et des croupions de dinde aux autres pays du Pacifique. Ces morceaux bon marché sont vite devenus les mets préférés des habitants des îles Samoa, Fidji et Tonga. Ces produits ont été tellement consommés que leur piètre qualité nutritionnelle a fini par rendre les populations du Pacifique malades. Au début des années 2000, Samoa a voulu rejoindre l’OMC, eh bien l’Organisation a forcé le pays à lever l’interdiction d’importer. En effet, selon les règles de cette organisation internationale, qui règlemente le commerce mondial, on ne peut interdire un produit dans son pays sans prouver qu’il est la cause des problèmes de santé invoqués. Faute de moyens pour commander des études probantes, Samoa n’a pas eu d’autres choix que de se plier aux injonctions de l’OMC et l’importation de la viande de mauvaise qualité a repris. Les industriels du tabac, quant à eux, ont remis en question au niveau de l’OMC les mesures prises par les gouvernements australien et uruguayen pour limiter la consommation de cigarettes. Mais il leur a fallu mener une longue bataille judiciaire, sans compter les frais d’avocats et d’experts. Les industriels peuvent ainsi faire pression sur un pays en arguant qu’une loi est contraire aux principes de libre-échange de l’OMC ; tant pis pour la santé des populations. Ils peuvent aussi convaincre en expliquant que si leur activité baisse les conséquences économiques seront désastreuses pour le pays. Parfois, ils vont devant les tribunaux nationaux. Cela a été le cas en Colombie quand une petite association a voulu dénoncer à la télévision les méfaits de la consommation de soda. Le propriétaire d’une des plus grosses chaînes de télévision du pays, parallèlement producteur de soda, a censuré la campagne empêchant sa diffusion à grande échelle. Mais l’association a gagné devant la Cour suprême de Colombie : il a été décidé que la santé et l’information des citoyens sur ce qu’ils consomment priment sur le droit de vendre des produits. Cependant, faute de temps et d’argent, les associations de consommateurs et celles qui s’engagent pour la préservation de la santé ne sont guère présentes dans les tribunaux à l’échelle internationale, quand il s’agit de s’opposer à l’OMC, par exemple. Par conséquent, les plateformes internationales sont de plus en plus privilégiées par les industriels pour faire pression sur nos pays.
Le discours ou l’art d’endormir les foules.
Outre les pratiques décrites jusqu’ici, repérables dans notre vie quotidienne, le “discours industriel ” imprègne nos sociétés. Ce discours, utilisé pour véhiculer des idées, est tenu par exemple pour lutter contre une proposition de loi défavorable, pour lui substituer l’autorégulation ou encore pour justifier des liens avec les chercheurs et l’approche des communautés. Ce discours, en pénétrant nos sociétés, influence notre perception des problèmes et de notre recherche de solutions pour notre santé et celle de la planète. Il est donc crucial d’identifier ce discours et d’en comprendre les limites lorsqu’on parle de l’influence des industriels sur notre santé.
Que serait l’économie sans l’industrie.
Tout d’abord, les industriels soulignent le rôle primordial qu’ils jouent dans nos économies et de l’emploi dans une ville, une région ou un pays. Ils se présentent comme des piliers pour le futur de ces territoires, dont ils contribuent à la croissance. Au Brésil, par exemple, quand il a été question d’apposer un nouvel étiquetage nutritionnel sur les aliments industriels, le lobby de l’industrie agroalimentaire a fait remarquer que le secteur fait vivre 1,6 million de Brésiliens, susceptibles ensuite de perdre leur emploi. La santé publique est considérée comme quelque peu secondaire. Oui c’est vrai, les industriels fournissent de l’emploi et développent notre économie. C’est un argument classique et très fort, surtout quand un industriel peut délocaliser ses activités. Dans certains pays, les industriels sont si puissants que ni les responsables politiques ni même les professionnels de la santé publique n’osent critiquer leurs produits. L’emploi fournit en est-il toujours bien un ? Nous savons qu’aujourd’hui l’industrie du cacao a toujours ses esclaves. Que les travailleurs ne sont pas toujours respectés. C’est du travail, cela participe à notre économie mondiale. Mais en matière de santé, qu’en est-il de la responsabilité des industriels ? L’argent qu’ils récoltent ne bénéficie pas forcément aux populations locales, car les impôts (quand ils sont payés…) sont parfois payés ailleurs. L’argent est souvent envoyé dans d’autres pays. Collectivement, nous devons nous demander : du travail, oui, mais à quel prix ? N’y a-t-il pas d’autres gisements d’emplois et d’argent plus respectueux des hommes et de la planète ?
Un ancrage local et de longue date.
Les industriels soulignent aussi la valeur “ historique ” de leurs activités. Dans un monde très mondialisé, les gens ont besoin de repères et redoutent l’ingérence d’autres pays. Par conséquent, les industriels parlent de moins en moins (hormis à leurs actionnaires) de leurs conquêtes de marchés à travers le monde. Au contraire, ils insistent sur leur ancrage local, leur petite échelle, leur dimension historique. Ainsi, le “ fabriqué en … depuis … ans ” est un argument de vente. Certaines entreprises insistent sur leur ancrage local alors que leur siège est ailleurs et que leurs revenus quittent nos pays. Les industriels jouent aussi sur les aspects historiques et sociologiques de l’alimentation ou de la consommation d’alcool. Oui, de tout temps l’homme a mangé. Oui, certains aliments et certaines boissons de grande consommation ont traversé l’histoire. Mais ne travestissons pas la réalité pour autant. Les aliments industriels ne ressemblent plus guère aux petits plats que cuisinaient nos ancêtres ; ils sont vendus à grand renfort de pratiques commerciales et politiques nocives, même quand l’alarme sonne, attirant notre attention sur les problèmes de santé qu’ils engendrent. On aurait pu continuer à poser et à respirer de l’amiante longtemps sous le couvert d’histoire, puisqu’elle était déjà utilisée il y plus de 4000 ans. Mais pour des raisons de santé, certains produits industriels appartiennent au passé.
Les industriels disent aussi soutenir l’agriculture, qu’il s’agisse de l’alimentation ou du tabac, par exemple. Le produit brut est de nature agricole, en effet. Les agriculteurs ne sont pas toujours d’accord avec cet argument, alors que les industriels clament qu’ils aident nos paysans. Souvent, ces derniers, alors qu’ils nous nourrissent, vivent très mal de leur métier et ne bénéficient pas du système tel qu’il existe. Il semblerait également que la proximité avec les campagnes affichées par les industriels sont assez loin de la réalité. Où sont-ils d’ailleurs ces industriels disposés à ouvrir les portes de leurs élevages (dans les conditions habituelles de travail, sans préparation de la visite) pour que le public puisse voir de ses propres yeux la symbiose entre industrie, paysans et animaux ?
Du bonheur en veux-tu en voilà.
Le bonheur est une notion essentielle pour les industriels. Être heureux, se sentir entouré, vivre pleinement est primordial pour l’être humain : nous sommes une espèce sociale. Les documents internes de l’industrie du tabac ont montré combien il est important pour toute industrie de cultiver une bonne image auprès du public, pour qu’il continue d’acheter ses produits bien sûr, mais aussi pour qu’il ne les critique pas plus que ses pratiques. Les industriels se sont donc immiscés dans nos vies à des moments clés : fêtes, évènements sportifs, sorties en boîte de nuit, colonies de vacances, etc. Coca-Cola, par exemple, associe son image à celle de Noël, via le père Noël, l’ours polaire et ses camions qui sillonnent les routes de nombreux pays à travers le monde. En 2020, en France, Coca-Cola faisait gagner un séjour à Disneyland pour les fêtes de fin d’année.
On nous vend de la magie, des paillettes, du bonheur. Toutes les pratiques visant les communautés sont généralement associées à la joie, au bonheur et à la prospérité. Les industriels insistent sur toutes ces bonnes actions dans leurs brochures de fin d’année, sourires d’enfants radieux, entre autres bénéficiaires ravis, à l’appui de leurs reportages maisons. Le bonheur, qui n’en veut pas ? Mais le discours tenu par l’industrie ne cadre pas avec les nombreuses pratiques nocives qui ont été décrites précédemment. L’aide aux communautés sert avant tout les industriels : secourir quelques individus, leur apporter un peu de joie via des produits ultra-transformés, c’est une bonne image garantie non seulement auprès des bénéficiaires, en particulier quand ils ont besoin d’aide immédiatement, mais aussi du grand public. Cette aide permet de se forger une bonne image mais aussi d’endormir la critique. En Colombie, par exemple, peut-on parler de bonheur quand les produits distribués sont malsains, quand le marketing est déguisé en arguments santé, ou quand les paramilitaires s’en prennent aux syndicalistes ?
Liberté, choix et responsabilité individuelle.
La notion de liberté individuelle, évidemment associée au bonheur (comment être heureux sans être libre ?), est chère aux industriels. Elle résonne chez tout le monde : qui n’a pas envie d’être libre ? De façon logique, quand on est libre, on fait ses propres choix, y compris en matière de santé, d’alimentation, de consommation. Les industriels nous font croire à cette liberté et à ce choix. Mélissa Mialon insiste sur le mot “ croire ” parce qu’en vérité la plupart des pratiques utilisées par les industriels restent largement ignorées du public et le privent de sa liberté. Les industriels insistent en effet sur la notion de choix concernant leurs produits. On peut choisir de les acheter, de les consommer… ou pas ; chaque individu est responsable. Prière cependant de passer sous silence leurs pratiques nocives, celles qui poussent à l’achat et à la consommation. J’ajouterai ici que sans une véritable connaissance de cause, car moins nous sommes informés sur les ingrédients des produits ultra-transformés et leurs effets sur notre santé, plus on achète et on consomme sans trop d’inquiétude. Dès lors que cette idée de liberté et de choix est associée à leurs produits, la plupart des industriels sont d’accord pour dire que l’alimentation peut contribuer ou nuire à notre santé. Par conséquent, pour faire pencher la balance du bon côté, ils nous proposent davantage de choix ! À nous de faire les bons. Il en est ainsi depuis que l’alimentation et santé sont corrélées. Le développement de produits et les reformulations battent aujourd’hui leur plein : ils sont devenus incontournables en matière de santé. L’offre de produits malsains n’a pas diminué, bien au contraire : nos supermarchés regorgent de déclinaison. Au rayon yaourts, par exemple, les “ classiques ” au lait de vache ont été rejoints par les “ allégés ” et les “ sans lait ”. Les nouveaux yaourts sont toujours ultra-transformés, donc rien n’a changé, mais nous avons l’illusion du choix ! Les alcooliers, de leur côté, proposent des boissons “ sans alcool ”, mais dont le contenant est similaire à celui des boissons alcoolisées, sans compter la marque qui reste la même. Sous couvert de santé, ils ont ainsi accès aux pays musulmans, aux femmes (qui sont généralement plus abstinentes que les hommes) et à tous les publics qui boivent peu ou pas d’alcool partout sur le globe. Avec le “ sans alcool ”, les industriels peuvent par la même occasion contourner les lois interdisant la publicité sur l’alcool, même si le contenant reste similaire. Le but est que la marque imprègne notre inconscient collectif. Et puis, “ faire dans la santé ”, comme c’est le cas actuellement, s’avère une affaire juteuse. Ce n’est pas en premier lieu pour le bien-être des populations que les industriels ont décuplé le choix à grand renfort d’arguments santé, mais plutôt pour protéger leurs marques et s’ouvrir de nouveaux marchés.
Au moins maintenant, on a un choix quasi illimité. Nous aurions pu nous détourner de l’alimentation industrielle et de l’alcool quand on a commencé à parler des problèmes de santé qu’ils engendrent, mais les industriels ont fait en sorte qu’il en soit autrement : pour garder les clients préoccupés qui auraient boudé les produits malsains, ils ont panaché l’offre. Et maintenant devant tant de choix, on est encore plus perdus qu’avant. Comment s’y retrouver ? Quels produits choisir ? C’est notre responsabilité, on a le choix !
Le poids de la liberté.
Libres de nos choix, nous ne pouvons blâmer les industriels ni pour leurs produits ni pour nos problèmes de santé, puisque c’est nous qui avons choisi ce que nous consommons. Nous sommes responsables ! L’observatoire du Centre national interprofessionnel de l’économie laitière, des habitudes alimentaire, par exemple, met l’accent sur les comportements individuels et nos choix alimentaires. Les alcooliers, dans leurs campagnes sur l’alcool et la sécurité routière, parlent quant à eux du buveur et non de la boisson alcoolisée (“ Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas ”). L’intérêt de l’industriel est de dissocier le problème du produit pour l’attribuer à l’individu. Malgré le lobbying qu’exercent à plusieurs niveaux les industriels pour empêcher la mise en place de politiques de santé publique, l’idée que l’individu est responsable de ses choix est intégrée par nos gouvernements. Au niveau national comme international, les solutions envisagées face à l’explosion des maladies non-transmissibles (entre autres problèmes de santé) reposent en premier lieu sur les comportements individuels. Pourtant, se focaliser sur la liberté, les choix et la responsabilité de l’individu, c’est ignoré le fait que tout le monde n’a pas le même accès à des aliments sains, que ce soit pour des raisons financières ou de disponibilité de l’offre à proximité. Nous avons accès à certains produits ou non, nous sommes bombardés de pubs ou non, selon l’endroit où nous vivons. Ainsi, au-delà de nos choix individuels, ce sont bien les produits malsains et l’exposition aux nombreuses pratiques des industriels qui représentent un risque majeur pour notre santé.
Du citoyen au simple consommateur.
Les industriels, dans leurs communications, réduisent souvent l’individu à son rôle de consommateur. Comme si manger, boire et être en bonne santé voulait seulement dire “ consommer ” un produit. Rappelons que nous sommes avant tout des citoyens, que l’acte de manger ne se limite, ni au supermarché ni au restaurant, qu’être en bonne santé, avant l’hôpital, c’est d’abord n’être exposé ni aux produits malsains ni aux pratiques nocives des industriels. En soulignant notre responsabilité, en nous cantonnant à notre rôle de consommateur, on minore notre rôle d’individu, de citoyen et surtout la responsabilité des industriels. C’est évidemment plus simple pour un gouvernement que de faire face à des lobbys puissants.
Plusieurs mouvements de citoyens, fondés sur la responsabilité individuelle, font la promotion des gestes que nous pouvons tous faire, chacun à notre échelle, pour notre planète par exemple. La cause est louable évidemment, mais elle ne règle pas le vrai problème : le système, responsable de nombreuses inégalités, qui est à l’origine de notre mauvaise santé et de celle de notre planète.
L’industrie et ses produits comme solution.
En faisant en sorte que nous considérions qu’une partie du problème, les industriels peuvent en effet passer pour des partenaires légitimes lorsqu’il s’agit de trouver de solutions. Dialoguer avec eux, les convier autour de la table est aujourd’hui habituel. Les partenariats avec les communautés, le financement de la recherche, la corégulation comptent parmi les réponses proposées pour juguler les maladies non-transmissibles, entre autres problèmes de santé modernes. Pour l’industrie, une occasion suffit pour ensuite faire partie de la solution. Par exemple, même si les accords signés entre les industriels de l’agroalimentaire et le gouvernement français il y a presque dix ans se sont révélés peu efficaces d’un point de vue santé, l’industrie s’y réfère maintenant pour montrer patte blanche. À partir du moment où elle s’instaure, la corégulation justifie de plus en plus de partenariats. Ces partenariats sont ensuite mis en avant, comme ce fut le cas par exemple lors des auditions de 2018 sur l’alimentation industrielle à l’Assemblée nationale française, où les industriels ont expliqué qu’ils progressaient, qu’ils étaient en train de s’améliorer. Inutile de voter des lois : les industriels maîtrisent, ils changent … même si en fait, pas vraiment.
Le problème est ailleurs.
Alors, puisqu’ils sont soi-disant en train de changer, les industriels parlent de food bashing ou de marketing de la peur quand les gens se questionnent sur leur alimentation. L’Association nationale des industries alimentaires a même lancé son propre site pour rétablir la “ vérité ” : alimentation-info-intox.fr. Il s’agit encore une fois de contrôler le discours et l’information. L’industrie est victime de food bashing : l’argument a été avancé par exemple à l’Assemblée nationale, lors des auditions sur l’alimentation industrielle évoquées précédemment. Autrement dit, il nous est interdit de nous interroger, sinon c’est à nous, citoyens, que revient la faute. Pour les industriels, le public est fautif. Super U a expliqué lors des mêmes auditions que les industriels ne font que suivre les attentes du public : ce sont les clients qui veulent tout garder si longtemps dans leurs frigos, ce qui obligent les industriels à ajouter des additifs… Les groupes interprofessionnels comme le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière s’intéressent également à l’orthorexie, l’obsession de bien manger. Ils ont financé les recherches d’une anthropologue à ce sujet. Une fois encore, cela permet de détourner l’attention vers les personnes qui se questionnent, toutes qualifiées d’orthorexiques, plutôt que sur qui est questionné : les industriels, leurs produits et leurs pratiques.
Information et éducation.
En désignant l’individu comme responsable du problème et en se présentant comme les principaux détenteurs de solutions, les industriels peuvent en proposer de nouvelles, au-delà de leurs produits. Ils se proposent alors d’éduquer et d’informer, ce qui n’est pas un problème en soi reconnait Mélissa Mialon. Rappelez-vous des programmes d’activité physique où l’information est fournie par l’industrie agroalimentaire. Toute une partie de la réalité est alors occultée – exit le rôle des aliments industriels dans notre mauvaise santé, par exemple – tandis que des populations sont approchées de façon subtile et se retrouvent à la fois influencées et exposées aux marques. Certains programmes sont plutôt axés sur l’alimentation, comme le projet Danone baptisé Clémentine, qui lui donne accès aux enfants des écoles dès le plus jeune âge. Sans ce prétexte d’éducation à l’alimentation, les industriels n’auraient peut-être pas pu s’approcher de nos enfants. Quel parent accepterait en effet, que Danone glisse des pubs dans les cartables, placarde des affiches publicitaires dans les cantines ou dans les classes ?
On vous donne le choix, on vous informe…
Après avoir lutté contre le Nutri-Score pendant des années, de nombreux industriels prétendent aujourd’hui approuver cet outil. Il leur faut en effet trouver le juste milieu : retarder l’adoption de politiques qui pourraient faire baisser la consommation des produits malsains, tout en soulignant qu’ils font partie de la solution, en l’occurrence en informant le consommateur ! En partageant l’information, celle qu’ils contrôlent, en éduquant nos enfants, les industriels peuvent encore plus dire que c’est la faute des gens. “ Que voulez-vous de plus ? On vous donne le choix, on vous informe … ” même si, en réalité, ils ne nous laissent qu’un choix et ne nous fournissent qu’une information dont ils peuvent tirer profit – cela, comme le rappelle Mélissa Mialon, en pleine épidémie industrielle.
Halte à la contamination.
Dans l’agroalimentaire toujours, les industriels mettent enfin en avant la “ sécurité ” de leurs aliments et la “ traçabilité ”. Cela en réponse aux fraudes et aux scandales récents : viande de cheval dans les lasagnes en Europe ou vache folle. L’argument de la sécurité alimentaire est souvent brandi. Or, si la sécurité sanitaire est importante, elle ne doit pas faire oublier que ce sont d’abord les maladies non-transmissibles qui affectent et menacent notre santé et que les industriels ne sont pas à une pratique nocive près. Et c’est bien parce que les industriels produisent une alimentation de masse qu’il faut en contrôler la sécurité sanitaire ; c’est l’échelle de mesure qui est le problème en vérité.D’ailleurs, si l’on veille à la sécurité sanitaire, c’est avant tout à cause de l’industrialisation de l’alimentation et non grâce à elle.
À la lumière de ce qui a été présenté jusqu’ici, se dégage l’idée générale qui sous-tend l’ensemble des pratiques nocives des industriels et qu’on peut résumer ainsi : tant qu’un produit malsain génère du profit, il doit rester sur le marché à tout prix, car la priorité c’est l’économie et “ accessoirement ” la santé publique et ce, tant qu’elle n’en n’affecte pas la vente.
Lire la suite : La bourse ou la vie, deuxième partie.
En savoir plus sur Pierre Varin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
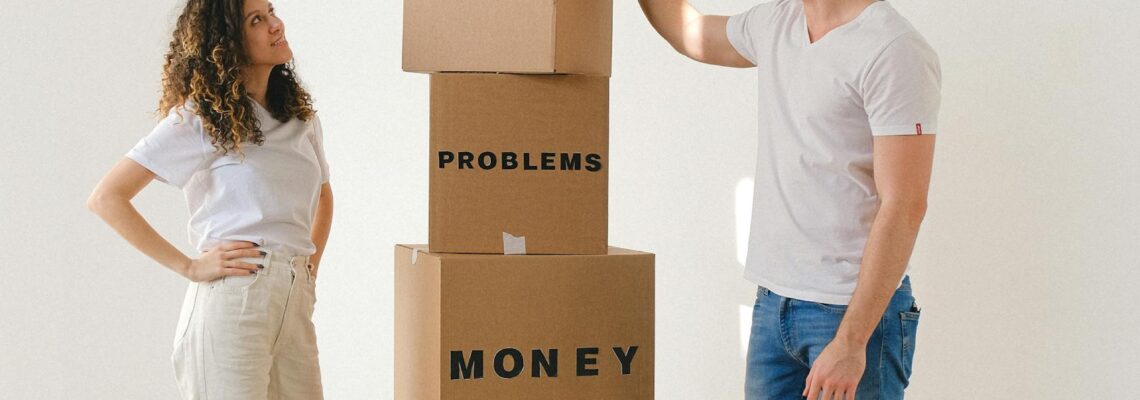
Laisser un commentaire